
Par: Marco BARATTO ★
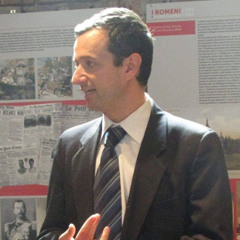
La récente décision du Rwanda de quitter la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) marque un tournant significatif dans la géopolitique du continent africain. Kigali a officiellement justifié ce retrait par des considérations géographiques et administratives, affirmant que son positionnement serait plus adapté à d’autres blocs économiques régionaux.
Toutefois, derrière cette explication technique se cache une dynamique politique bien plus profonde. Ce geste représente un signal fort de rupture avec les institutions multilatérales africaines et s’inscrit dans une trajectoire d’isolement régional et continental croissant du Rwanda.
Parallèlement, ces dernières années ont été marquées par un rapprochement stratégique entre le Rwanda et l’Algérie. Une alliance qui peut paraître surprenante au vu de la distance géographique et des parcours historiques distincts des deux pays, mais qui s’explique aisément lorsqu’on analyse leurs comportements politiques similaires et leurs visions géopolitiques convergentes. Le Rwanda et l’Algérie consolident une coopération fondée sur des intérêts partagés et une posture commune de défi vis-à-vis de l’ordre continental africain.
La promotion du séparatisme comme outil géopolitique
L’un des points clés qui rapproche ces deux pays est leur soutien – direct ou indirect – à des mouvements séparatistes dans des zones stratégiques du continent. Le Rwanda est depuis des années accusé, notamment par la République Démocratique du Congo (RDC), de soutenir des groupes armés tels que le M23, qui opèrent dans l’est congolais. Ces groupes sont responsables d’un conflit qui a causé des milliers de morts et des millions de déplacés. Kigali a toujours nié ces accusations, mais des rapports des Nations Unies et d’observateurs indépendants confirment une implication plus que probable du gouvernement rwandais dans les dynamiques de guerre dans la région des Grands Lacs.
L’objectif stratégique ne se limite pas à l’exploitation de ressources naturelles précieuses (coltan, or, minerais rares), mais vise aussi à affaiblir l’intégrité territoriale de la RDC, un pays vaste et potentiellement influent, mais miné par l’instabilité chronique. Dans ce contexte, la politique extérieure rwandaise semble favoriser le maintien d’une zone d’influence dans l’est congolais, en utilisant la fragmentation territoriale comme levier géopolitique.
De manière similaire, l’Algérie est depuis longtemps le principal soutien du « polisario ». Alger fournit un appui politique, militaire et logistique constant au « polisario » et accueille sur son territoire les camps de sahraouis de Tindouf. Là encore, la promotion du séparatisme s’inscrit dans une logique de rivalité régionale avec le Maroc, un adversaire historique de l’Algérie.
Deux pays marginalisés de l’ordre africain
Les choix géopolitiques du Rwanda et de l’Algérie ont contribué à leur marginalisation croissante sur la scène africaine. L’Algérie, malgré son poids énergétique en Afrique du Nord, voit son influence diplomatique s’éroder en raison de son repli institutionnel, de l’absence de réformes internes et d’une politique étrangère figée dans des logiques héritées de la Guerre froide. Le refus du dialogue avec le Maroc et l’approche rigide sur la question du Sahara ont réduit sa capacité à jouer un rôle de médiateur crédible.
De son côté, le Rwanda – autrefois présenté comme un modèle de reconstruction post-conflit et de développement – connaît un isolement grandissant. Les tensions croissantes avec la RDC, les accusations d’ingérence militaire, la répression politique interne et les dérives autoritaires du régime de Paul Kagame ont écorné l’image du « miracle rwandais ». La sortie de la CEEAC est l’un des signaux les plus forts de ce désengagement des plateformes multilatérales dans lesquelles Kigali ne parvient plus à imposer son agenda.
Cet isolement, loin d’être subi, est en grande partie choisi. Les deux pays privilégient une diplomatie bilatérale fondée sur des alliances sélectives et des rapports de force, au détriment d’une approche collaborative et multilatérale. Dans ce cadre, le rapprochement entre l’Algérie et le Rwanda apparaît comme une alliance tactique entre deux États qui contestent, de manière plus ou moins ouverte, l’ordre panafricain actuel.
Conséquences pour le continent africain
L’émergence d’un axe Algérie-Rwanda n’est pas sans conséquences pour le reste du continent. D’un côté, elle accentue la fragmentation régionale. Le retrait du Rwanda de la CEEAC affaiblit une organisation déjà fragile et envoie un signal négatif sur la viabilité des efforts d’intégration. De l’autre, le soutien à des mouvements séparatistes dans des régions sensibles comme les Grands Lacs ou le Sahara alimente les conflits latents, exacerbe les tensions et menace la stabilité régionale.
De plus, cette alliance remet en cause les fondements de l’Union africaine (UA), qui repose sur le respect de l’intégrité territoriale des États membres et sur la recherche de solutions politiques aux conflits séparatistes. En s’associant pour soutenir ou tolérer des mouvements indépendantistes, l’Algérie et le Rwanda sapent les principes de l’ordre continental et risquent d’encourager d’autres velléités séparatistes à travers l’Afrique.
Conclusion
Le rapprochement stratégique entre le Rwanda et l’Algérie, dans un contexte de marginalisation croissante des deux pays, constitue une évolution géopolitique inquiétante pour l’Afrique. Il ne s’agit pas simplement d’une coopération bilatérale, mais d’un alignement idéologique et stratégique entre deux États qui utilisent le séparatisme comme instrument d’influence régionale. La sortie du Rwanda de la CEEAC n’est pas un simple réajustement technique, mais un symptôme d’une recomposition des alliances en Afrique. En s’associant autour d’agendas perturbateurs et en contestant les structures de gouvernance continentale, le Rwanda et l’Algérie ouvrent la voie à une phase de polarisation et d’instabilité accrue. À un moment où l’Afrique a besoin d’unité, de dialogue et d’intégration pour relever les défis du XXIe siècle, cette dynamique fragmentaire est particulièrement préoccupante.
★Marco Baratto, essayiste italien, auteur du livre « Le défi de l’Islam en Italie »




