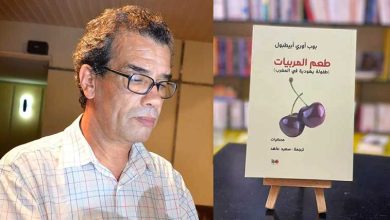Par Mustapha Saha*
William Klein, l’infatigable défenseur de causes perdues, l’inlassable créateur d’esthétiques suspendues, l’indéfectible agitateur de révolutions perdues, est parti le samedi 10 septembre 2022, à l’âge respectable de 96 ans. Spleenétique été. Disparitions en série d’amis fidèles, des artistes exceptionnels avec qui j’ai travaillé, Jean-Jacques Sempé (1932 – 2022), Alain Tanner (1929 – 2022), qui nous a filmés, avec Omar blondin Diop notamment (Alain Tanner et Jean-Pierre Goretta, Mai 68 à Paris), William Klein (1926 – 2022) (William Klein, Gros soirs et petits matins, 1968 – 1978).
William Klein fusionne les apparences, les références, les occurrences, la peinture, l’écriture, la photographie, le cinéma, la pop culture, le psychédélisme, l’underground, la contestation, l’insubordination. 1958, il réalise le court métrage Broadway by light. Il prend le pouls de la vie nocturne newyorkaise. Il subvertit les formes et les couleurs. Une rythmologie urbaine réglée sur les enseignes lumineuses. La jungle scintillante perd sa vitalité au lever du jour. Fulgurance introductive: « Les américains ont inventé le jazz pour se consoler de la mort. Ils ont créé Broadway pour s’apaiser de la nuit ». L’implacable logique diurne, le tout visible en surface, indécelable en profondeur, explose la nuit en pyrotechnie.
Avec New York, Life is good and good for you in New York, William Klein trance witness revels, l’artiste rompt radicalement avec les codes institutionnalisés du reportage. Il intègre les décadrages, les flous, les artefacts. La photographie se libère des compositions contraignantes. L’instant décisif n’est pas donné au départ. Il faut le créer. L’esthétique traditionnelle est bouleversée par les bricolages techniques, les grossissements, les bougés, les dilatations, les déformations, les jeux des ombres et des lumières. La recherche de formes détonantes relègue au second plan les moments significatifs, les éléments explicatifs. La singularité personnelle prime sur le motif. Les spécificités du médium l’emportent sur la substance informative. La texture floutée, la matérialité médiumnique deviennent des données premières de l’art photographique. Les photographes sont des artistes à part entière. La photographie n’est qu’un support parmi d’autres.
1967. Le long métrage collectif Loin du Vietnam alterne le documentaire et la fiction, le simulacre de théâtre et la réalité brute. Les onze séquences sont réalisées par William Klein, Chris Marker, Joris Ivens, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Claude Lelouche. Guerre du Nord contre le Sud, de l’Occident contre l’Orient. Participent à l’aventure Jean Lacouture, François Maspéro, pierre angulaire du vocabulaire, et cent cinquante techniciens. Les étudiants de Nanterre sont, au moins en partie, à l’origine du projet. Ils demandent à Chris Marker, dès 1966, un film susceptible d’accompagner leurs débats. Mai 68, prémonitoirement annoncé par La Chinoise de Jean-Luc Godard, se profile à l’horizon. La rhétorique de Loin du Vietnam s’inscrit dans un dualisme éthique. « The rich get richer, the poor get killed », les riches de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus exterminés. Le message est binaire, clair, efficace. Mélange des styles, des genres, avec une exigence de cohérence qui exclut les contributions d’Agnès Varda, de Jacques Demi, de Ruy Guerra, bobines à jamais perdues. Guernica de Pablo Picasso illustre l’intention. L’animation de Folon, les œuvres de Roy Lichtenstein, l’esthétique du collage, orientent le regard vers le pop art. Les actualités cruelles s’insèrent dans un univers artistique.
Je me souviens de la projection de Loin du Vietnam au Palais de Chaillot, du débat qui a suivi avec les réalisateurs, de l’enthousiasme solidaire des deux mille spectateurs. Pour la première fois, un film provoque une réflexion sur un événement réel. Le dossier composé d’optiques différentes, d’approches hétérogènes, reflète la diversité de perceptions du même phénomène, la passion pour la cause vietnamienne en partage. Les crimes contre l’humanité s’exhibent impunément sur les écrans comme des performances technologiques, des prouesses invulnérables, des écrasements imparables. « La guerre du Vietnam, qu’est-ce que c’est pour vous, pour nous, qui assistons de loin, oui, qui assistons la rage au cœur et les yeux ouverts sur l’horreur, mais rivés sur place, en spectateurs révoltés ou pas, conscients ou non de ce qui se joue là-bas, quotidiennement sollicités, harcelés, tenus en haleine, en éveil par l’information multiforme, la presse, la radio, la télévision qui ont rendu cette guerre comme jamais dans l’histoire, immédiatement présente et perceptible à chacun, dans chaque foyer, à chaque instant, et en direct comme une opération à cœur ouvert ? » (Michel Capdenac, Loin du Vietnam, Les lettres françaises, 18 décembre 1967).
Le film est victime de plusieurs alertes à la bombe et d’une attaque du cinéma Kinopanorama par un commando du groupuscule fasciste Occident. Sa diffusion dans les salles est définitivement compromise. « Des manifestants du mouvement Occident interrompent la projection du film Loin du Vietnam. Deux blessés, deux arrestations » (Le Monde, 21 décembre 1967). Nous organisons en contre-attaque plusieurs projections à la faculté de Nanterre. Aux Etats Unis, le film est critiqué par la presse, mais chaleureusement reçu par le public. « Le film Loin du Vietnam, présenté au Festival de New-York, a été salué, au Lincoln Center, par une ovation » (Le Monde, 4 octobre 1967). D’emblée, des images d’un porte-avions de la septième flotte filmés sur place par Claude Lelouche fait toucher du doigt le contraste entre une énorme machine de guerre et les outils artisanaux d’un peuple vietnamien qui la tient en échec. « Jean-Luc Godard, faute d’avoir pu tourner les images dont il dit avoir rêvé, offre un long monologue dont les idées ne peuvent faire oublier le narcissisme qui l’encombre et relègue le pays en flammes loin derrière une agaçante méditation obsessionnelle » (Claude Julien, Le Monde, 4 octobre 1967).
Le 21 octobre 1967, Chris Marker et François Reichenbach filment en couleurs, pas à pas, la gigantesque manifestation contre la guerre au Vietnam à Washington, qui se donne comme objectif symbolique l’occupation du Pentagone. Cette première marche fait descendre les protestations universitaires dans la société civile. Des étudiants brûlent leur fichier militaire devant les caméras. Des actions concrétisent l’engagement, interdiction d’accès aux enceintes universitaires des recruteurs de l’armée, aide aux insoumis. Demeure de cette journée l’emblématique photographie de Marc Riboud d’une étudiante offrant une fleur aux soldats. Une époque révolue où l’Amérique libérale, encore confiante dans sa puissance indestructible, autorise la liberté d’expression. Les images d’un pays en déperdition ébranlent durablement l’opinion. La guerre du Vietnam se perd sur le tapis bleu de la communication. En bombardant le Nord-Vietnam en février 1965, les américains rallument les brasiers mal éteints des guerres coloniales. Ils ouvrent une période marquée par des convergences anti-impérialistes entre étudiants occidentaux et intellectuels du tiers-monde. La mobilisation contre la guerre du Vietnam devient le catalyseur international des révoltes.
1968. William Klein et Kris Marker nous rejoignent à la Sorbonne, à l’Odéon, aux Beaux-Arts, dans les quartiers généraux du Mouvement du 22 Mars, institutions décloisonnées, affranchies de leur tutelle étatique, rendues à la créativité de leurs usagers. Nos affinités intellectuelles s’imposent dès la première rencontre. Je poursuis, à la Faculté de Nanterre, des études en sociologie urbaine avec Henri Lefebvre. Nous partageons les mêmes convictions pour une culture cosmopolite, diversitaire, plurale. Je découvre les livres de William Klein sur les grandes villes, New York (éditions du Seuil, 1956), Rome (éditions du Seuil, 1958), Tokyo (éditions Delpire, 1964). Les critiques mondains, fascinés par la concupiscence de leur propre monde, le qualifie d’esthète du chaos. William Klein s’est toujours assumé comme un artiste anarchiste, au plein sens philosophique du mot, contre toutes les formes de pouvoir, contre toutes les formes d’oppression. Son art se nourrit des palpitations de la vie réelle dans ses enchevêtrements, ses tumultes, ses marasmes.
Mai 68, notre territoire. William Klein habite au cœur du quartier latin. Nous nous réunissons souvent dans son salon devenu un prétoire révolutionnaire. L’Ecole nationale de photographie et de cinéma, rue Vaugirard, nous fournit des caméras. Nous jouons aux chasseurs d’images. William Klein mène la danse du cinéma de rue. Hantise permanente de nous faire confisquer les pellicules par la police. Les films sont développés en Belgique et en Italie. Nous immortalisons sur le vif l’incandescence urbaine. Chaque instant apporte ses imprévisibilités. Nous voulons saisir l’insoupçonnable au vol. Les rues se transforment en agoras grouillantes. Les lampadaires se métamorphosent en arbres à palabres. A l’atelier populaire des Beaux-Arts, je conçois une affiche avec le slogan La beauté dans la rue la laideur au pouvoir et une étudiante jetant un livre sur la police. L’assemblée simplifie la légende en La beauté est dans la rue et me fait remanier le livre en pavé. Je reprends par la suite l’alexandrin dans mon poème Le Temps des barricades.
En février 2012, nous rendons hommage, William Klein et moi, à notre ami commun Pierre Clémenti dans le cadre des Journées Cinématographiques Dionysiaques de Saint-Denis. Nous évoquons les week-ends interminables passés dans la maison de Pierre Clémenti à Croissy avant qu’il ne tombe dans un traquenard italien. Je réalise une affiche pour l’événement. Pierre Clémenti, mémorable acteur dans les films Luis Bunuel, Pier Paolo Pasolini, Glauber Rocha, Jacques Rivette, James Ivory…, auteur et metteur en scène au théâtre de Chronique d’une mort retardée, figure discrète de l’underground français, réalisateur de films inclassables, Visa de censure n° X, La Révolution n’est qu’un début, continuons le combat, carte de vœux, L’Ange et le Démon, New Old, Cheick point Charlie, A l’Ombre de la canaille bleue…, emporté prématurément par un cancer du foie en 1999, à l’âge de 57 ans. William Klein me dit « Nous sommes les derniers témoins ». Je pense qu’il fait allusion à Mai 68. Je lui demande : « Témoins de quoi ? ». Il me répond : « Les derniers témoins de la décomposition du monde ».
*Mustapha Saha, sociologue, poète, artiste peintre, cofondateur du Mouvement du 22 Mars et figure historique de Mai 68. Ancien sociologue-conseiller au Palais de l’Elysée. Nouveaux livres: « Haïm Zafrani. Penseur de la diversité » (éditions Hémisphères/éditions Maisonneuve & Larose, Paris, 2020), « Le Calligraphe des sables », (éditions Orion, Casablanca, 2021)