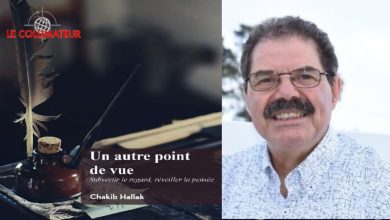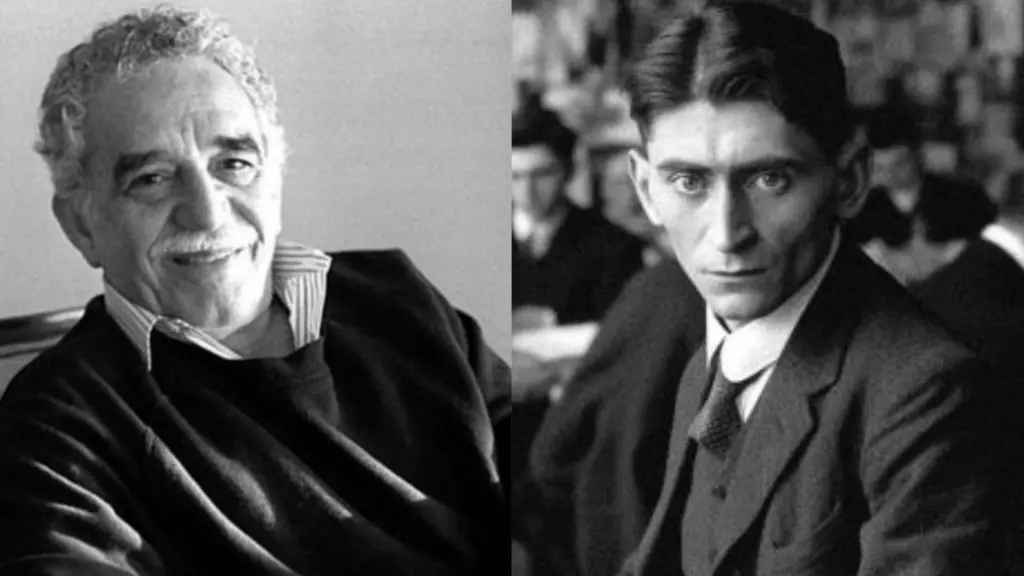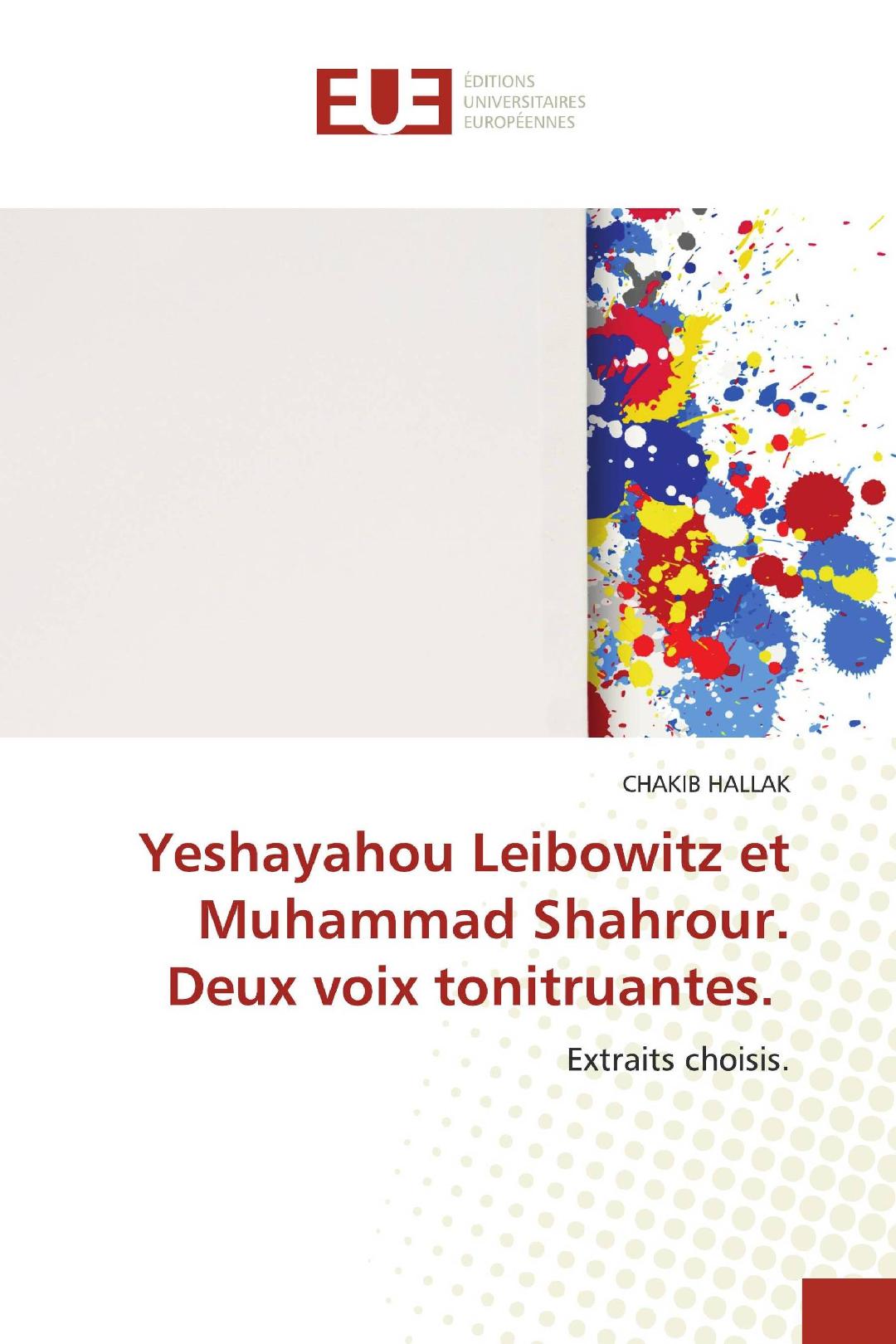Par: Chakib HALLAK*

Le dernier battement du cœur, le dernier souffle, la dernière pensée, la dernière parole. L’instant où la vie cède la place à la mort a toujours préoccupé et fasciné l’homme. Parce que c’est son propre sort qui est en jeu et que des questions vertigineuses l’assaillent alors. À commencer par savoir ce qui distingue les vivants des morts ? Le grand chirurgien français Xavier Bichat a défini la vie, il y a deux siècles, comme «l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort».
En réalité, la mort ne peut être définie autrement que par l’absence de ces trois fonctions vitales: la respiration, la circulation sanguine et l’activité cérébrale. Si l’une de ces fonctions vient à manquer à l’appel, les deux autres déclinent immédiatement, entraînant à terme la destruction de toutes les « fonctions qui résistent à la mort ».
L’une des conséquences de cette vérité scientifique est que la plupart des gens considèrent la mort comme quelque chose d’horrible et de redoutable. Dans toutes les sociétés, l’idée de la mort est négative, effrayante ou triste. D’ailleurs, dans la culture européenne, l’esprit qui emporte l’âme est appelé la Faucheuse.
Que se passera-t-il ensuite? Voici la question la plus difficile et incertaine pour certains : Y a-t-il une vie après la mort ? Dieu existe-t-il ?
Les arguments en faveur de l’existence de Dieu ont fait l’objet de vives discussions tout au long de l’histoire, et l’on trouve des personnes très intelligentes des deux côtés de l’argumentation. Au cours des derniers siècles, les arguments contre l’existence de Dieu ont pris une forme plus militante, et quiconque ose encore croire est accusé de courir après une chimère ou taxé d’irrationalité.
– Karl Marx affirmait que la croyance en Dieu était le signe d’un désordre mental affectant la pensée.
– Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a écrit que la croyance en un Dieu créateur était une illusion fondée uniquement sur des « espoirs inassouvis », conduisant à une position qu’il jugeait inacceptable.
– Le philosophe Friedrich Nietzsche a précisé que croire revenait à refuser de voir la vérité en face.
Aujourd’hui, une nouvelle génération d’athées, comme André Comte-Sponville, affirme «qu’aucune croyance n’est plus suspecte que l’existence de Dieu.»
Dans son livre L’esprit de l’athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu (Éditions Albin Michel, Paris, 2006) , André Comte-Sponville parle de six arguments: les trois premiers l’amenant à ne pas croire en Dieu et les trois derniers le poussant à croire que Dieu n’existe pas.
Voici les six arguments :
La faiblesse des arguments opposés (les prétendues « preuves » de l’existence de Dieu):
– La preuve ontologique. Preuve a priori (avant ou sans l’expérience) par le concept d’infini, de parfait.
– La preuve cosmologique ou par la contingence du monde.
– La preuve physico-théologique. S’il y a un ordre dans l’univers, le créateur de cet ordre intelligent est Dieu.
La faiblesse des expériences: l’expérience commune (si Dieu existait, cela devrait se voir ou se sentir davantage).
Une explication incompréhensible: le refus d’André Comte-Sponville d’expliquer ce qu’il ne comprend pas par quelque chose qu’il comprend encore moins.
La démesure du mal ou l’excès du mal.
La médiocrité de l’homme.
Le désir et l’illusion: le fait que Dieu corresponde tellement bien à nos désirs qu’il y a tout lieu de penser qu’il a été inventé pour les satisfaire, au moins fantasmatiquement (ce qui fait de la religion une illusion au sens freudien du terme).
Pour cet article, nous reprenons et clarifions un seul argument, celui de la faiblesse des expériences car c’est l’argument le plus simple et l’un des plus forts, selon Comte-Sponville.
«La plupart de nos théologiens et quelques-uns de nos philosophes, dit-il, se donnent du mal pour nous convaincre que Dieu existe. Mais, enfin il serait plus simple, et plus efficace, que Dieu consente à se montrer! C’est toujours la première objection qui me vient, lorsqu’un croyant essaie de me convertir. «Pourquoi te donnes-tu tant de mal? Ai-je envie de lui demander. Si Dieu voulait que je crois, ce serait vite fait! S’il ne le veut pas, à quoi bon t’obstiner».»
Ce raisonnement nous semble simpliste. Dans l’univers, il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas, mais dont nous ne pouvons pourtant pas nier l’existence. Qui d’entre nous a vu l’électricité ? Personne ne la voit, mais nous en ressentons les effets dans l’allumage des lampes, le fonctionnement des moteurs, etc. Il y a le son et les ondes électromagnétiques, que nous touchons sans les voir, et il y a des micro-organismes que l’œil nu ne voit pas, mais dont nous croyons qu’ils existent et que nous pouvons voir avec un microscope. Il y a aussi des sons faibles que nous ne percevons pas avec nos oreilles, alors que certains animaux les perçoivent.
Dieu se cache pour respecter et même permettre notre liberté. S’il se montrait dans toute sa gloire, nous n’aurions plus le choix quant à la croyance ou à la non-croyance en lui. La foi ne serait alors plus une croyance, mais une évidence. Si Dieu était « sans cesse devant nos yeux », cette certitude nous obligerait, comme le dit Kant, à une soumission intéressée. Ce ne serait alors plus de la morale, mais de la prudence. Nous ne transgresserions certes pas les commandements, la loi morale serait respectée, mais uniquement par intérêt personnel: «La plupart des actions conformes à la loi seraient produites par la craintes, quelques-unes seulement par l’espérance et aucune par devoir», si bien conclut Kant, que «la valeur morale des actions n’existerait plus.» Nous serions comme «des marionnettes» de l’égoïsme, dont l’espoir (d’une récompense) et la peur (d’un châtiment) seraient les ficelles. «Tout gesticulerait bien», mais c’en serait fini de notre liberté.» Argument faible, nous dit André Comte-Sponville, pour trois raisons:
1) «La première, dit-il, c’est que si Dieu se cachait pour nous laisser libres, si l’ignorance, pour le dire autrement, était la condition de notre liberté, nous serions plus libre que Dieu lui-même, puisqu’il n’a pas le choix, le pauvre, de croire ou non en sa propre existence! Nous serions aussi plus libres que tel ou tel de ses prophètes ou propagandistes, auxquels il se serait, selon la tradition, manifesté directement (…) L’idée que nous soyons, nous, les humains plus libres que Dieu, ou même plus libres qu’Abraham, saint Paul ou Muhammad (…) me paraît aussi impossible à accepter, d’un point de vue théologique, que difficile d’un point de vue philosophique à penser…»
2) «La deuxième raison (…) c’est qu’il y a moins de liberté dans l’ignorance que dans la connaissance.
C’est l’esprit des Lumières, toujours vivant, toujours nécessaire, contre tout obscurantisme. Prétendre que Dieu se cache afin de préserver notre liberté ce serait supposer que l’ignorance est un facteur de liberté. Quel enseignant pourrait l’accepter? Quel parent digne de ce nom? Si nous voulons que tout enfant puisse avoir accès à l’école, c’est parce que nous pensons, à l’inverse, qu’il y a plus de liberté dans la connaissance que dans l’ignorance (…) Quant à l’argument de Kant (…), il montre surtout que les idées de récompense et de châtiment, d’espoir et de crainte, sont foncièrement étrangères à la morale, et ne peuvent, si on les absolutise, que la pervertir. J’en suis d’accord. Agir moralement, c’est agir de façon désintéressée, montre Kant, ce qui suppose qu’on fasse son devoir «sans rien espérer pour cela». J’applaudis des deux mains. Mais cela fait un argument contre l’enfer et le paradis, bien davantage qu’une justification de l’ignorance humaine ou de la dissimulation divine.»
3) «La troisième raison (…) c’est qu’elle me paraît incompatible avec l’idée- si belle et fortement ancrée dans la tradition qui est la nôtre- d’un Dieu Père. J’ai trois enfants. Leur liberté, du temps qu’ils étaient petits, c’était de m’obéir ou pas, de me respecter ou pas, éventuellement de m’aimer ou pas. Encore fallait-il qu’ils sachent que j’existe! Encore fallait-il que je m’en occupe assez pour qu’ils puissent en effet devenir libres. Que penseriez-vous d’un père qui se cacherait de ses enfants? (…) Vous penseriez que ce père est un malade, un fou, un monstre. Et quel père faudrait-il être pour se cacher encore à Auschwitz, au Goulag, au Rwanda, quand ses enfants sont déportés humiliés, affamés, assassinés, torturés? L’idée d’un Dieu qui se cache est inconciliable avec l’idée d’un Dieu Père», selon Comte-Sponville.
En guise de conclusion, il reste une dernière question en suspens: celle de la validité de cette position athée. Puisque Comte-Sponville remet en cause celle du croyant, il est tout à fait raisonnable de lui renvoyer la question. Tout d’abord, il faut savoir que la position athée (étymologiquement : « sans Dieu ») ne peut pas être justifiée philosophiquement. Le philosophe américain Mortimer Adler disait :
«Une hypothèse existentielle affirmative peut être vérifiée, mais une hypothèse existentielle négative, une proposition qui nie l’existence de quelque chose, ne peut être vérifiée.» («An affirmative existential proposition can be proved, but a negative existential proposition – one that denies the existence of something – cannot be proved.»)
Par exemple, une personne peut affirmer que les vaches bleues existent et une autre qu’elles n’existent pas. La première n’a qu’à trouver une seule vache bleue pour prouver son affirmation, tandis que la seconde devrait explorer l’univers entier et être partout à la fois pour s’assurer qu’aucune vache bleue ne lui a échappé à un endroit et à un moment donnés, ce qui est impossible. C’est pourquoi les athées intellectuellement honnêtes admettent ne pas pouvoir prouver l’inexistence de Dieu.
Deuxièmement, il est important de comprendre la portée d’une affirmation et les preuves nécessaires pour parvenir à une conclusion. Par exemple, si quelqu’un vous offre deux verres de limonade et vous dit que l’un est plus acide que l’autre, avec des conséquences mineures pour le choix du plus acide, vous pourriez prendre le risque de prendre une décision sans trop vous soucier des preuves. En revanche, si la personne a ajouté de l’édulcorant dans un verre et de la mort-aux-rats dans l’autre, vous devrez procéder à des tests plus poussés avant de prendre une décision. ( Cf, Y a-t-il des arguments en faveur de l’existence de Dieu? Article publié sur internet)
C’est la situation dans laquelle chacun doit choisir entre athéisme et croyance en Dieu. Étant donné que l’athéisme peut avoir des conséquences éternelles et irréparables, les athées doivent défendre leur position avec des arguments solides. Toutefois, l’athéisme n’apporte pas de preuves suffisantes pour étayer une telle affirmation. Au lieu de cela, les personnes convaincues de cette position croisent les doigts pour l’éternité en espérant ne jamais être confrontées à la vérité dérangeante que Dieu existe.
Comte-Sponville est bien conscient de cette situation car il explique que vivre sans croire en Dieu n’est pas la solution de facilité, bien au contraire. « Je préférerais que Dieu existe, c’est ce que je désire par-dessus tout. Ce serait plus facile et agréable. Aucune existence n’est plus désirable que celle de Dieu car c’est réconfortant d’avoir une vie après la mort, de ressusciter, de retrouver les êtres chers que nous avons perdus et d’être aimé d’un amour infini. Qu’espérer de mieux ?» Mais plutôt que de relativiser ces conclusions, il souligne: «si nous avons un esprit, c’est pour nous en servir. Ce n’est pas pour penser ce qui est le plus agréable, mais le plus vraisemblable. Aucune croyance n’est plus suspecte que l’existence de Dieu .» (Source: Le quotidien genevois Le Courrier le samedi 20 mai 2011.
*Enseignant-chercheur à Paris