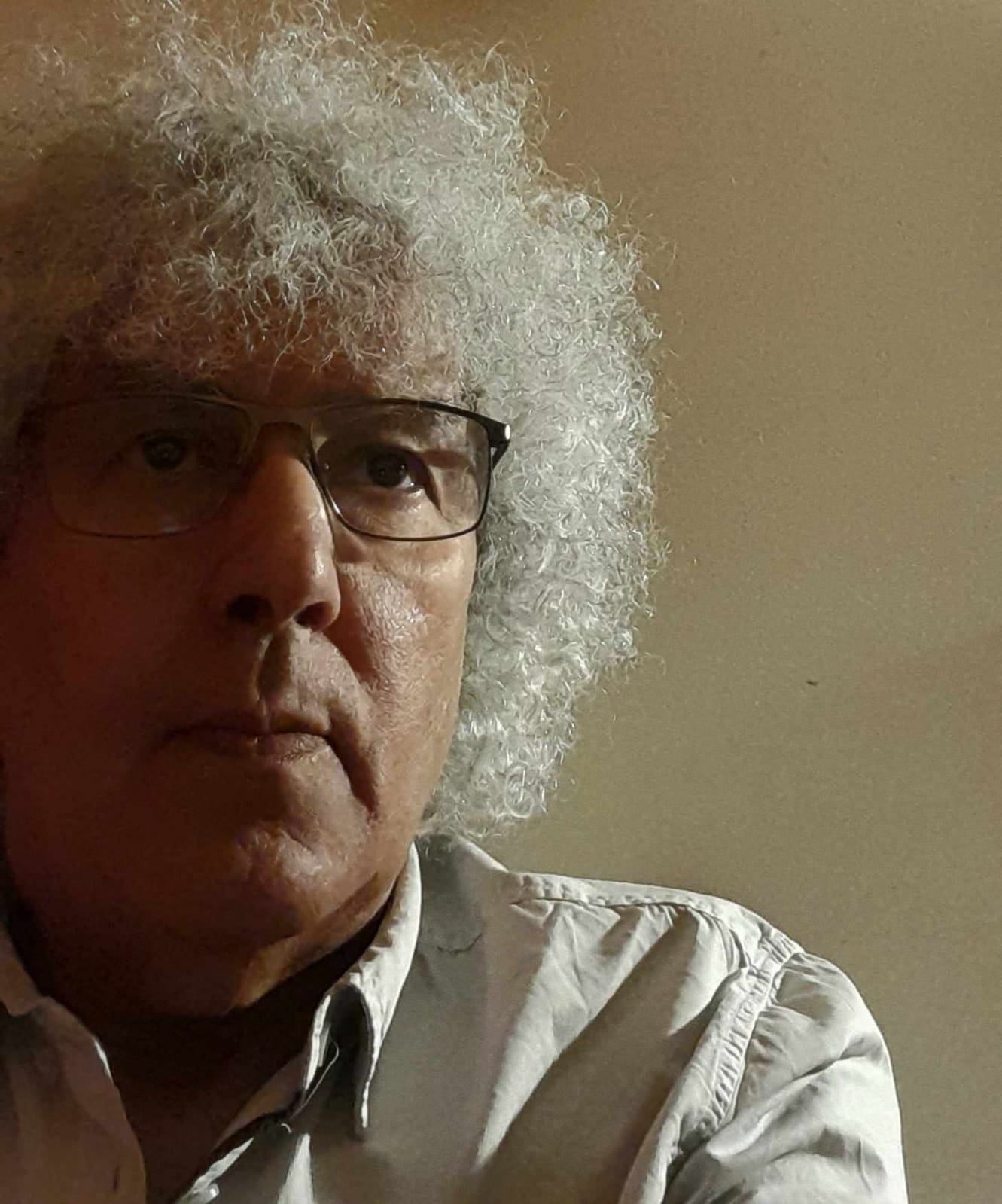
Par Nasser-Edine Boucheqif*
Si le contrat n’est plus le présupposé du mouvement social, qui permet de comprendre le rapport de force précis sur lequel un pouvoir repose, pouvons-nous parler d’un contrat physique sans dénaturer la pensée de B. Spinoza ? Dans quelle mesure pouvons-nous dire, alors, que la société existe toujours déjà sous quelque forme que ce soit et qu’il n’y a pas de moment fondateur dans la vie d’une communauté ?
Pour quelles raisons Spinoza peut-il soutenir l’idée que les individus se combinent inévitablement avec d’autres individus, que ce soit par l’imitation des affects qui les lient ensemble ou par les affects socialisants des entreprises religieuses et politiques (processus qui s’opèrent tous deux indépendamment de la volonté des individus) pour former des entités nouvelles plus puissantes ?
Spinoza définit le droit de nature par le droit et la puissance. La société s’enracine dans la nature et le droit naturel se conserve et se maintient dans les marges du droit civil. Loin de déplorer les passions humaines en ce qu’elles ont d’antisocial, il est plus réaliste de penser leurs combinaisons et de les faire jouer contre elles, au service de la communauté. L’envie, la paresse, la haine, le désir de domination, de luxe, la mauvaise foi sont des obstacles à la vie sociale qui peuvent être relativement contrebalancés par ces aspirations passionnelles à la vie politique que sont le désir de paix, de savoir et l’aspiration au mieux vivre.
Le rôle d’une politique bien comprise est de faire jouer les passions les unes contre les autres, créer un système de régulation qui prenne en compte la fluctuation des affects, des puissances et les aspirations à la raison. Nous ne passons pas de l’état de nature à l’état civil en abandonnant l’un pour l’autre. Le passage à une forme institutionnalisée de l’État ne peut supprimer les affects-passions, les hommes ne peuvent se soustraire aux lois de la nature, au contraire l’État les requiert nécessairement pour sa propre conservation. Nous analyserons ensuite la question du transfert de droit au regard de sa théorie des affections de L’Éthique III. B. Spinoza semble réduire le problème du transfert à une forme de dépendance passionnelle. Le transfert est transfert d’affects, les hommes partagent mécaniquement leur joie et leur tristesse parce qu’ils les éprouvent eux-mêmes par imitation. Ce flux continu s’opère à travers le filtre de l’imagination et de façon tout à fait irrationnelle, irrationnelle et difficilement contrôlable. Nous verrons qu’une grande partie des flux d’affects échappe irrémédiablement aux pouvoirs des dirigeants politiques.
- Spinoza s’applique à considérer le concret avec pertinence. Les prophètes, par exemple, sont très utiles à un moment contre une foule terrible quand elle est sans crainte et deviennent mortels à un autre moment à mesure qu’il grandit, devient explosif. C’est en partie pourquoi Spinoza s’attache à déconstruire le nexus théologico-politique. La théologie a certes une utilité d’ordre social et politique mais elle ne doit pas gouverner. Spinoza distingue l’ordre de la connaissance de celui de la croyance. Il redéfinit la religion et l’engage dans le processus éthico-politique de libération.
Cette conception du corps politique, complètement ancrée dans la nature, renforce l’idée d’une physique sociale. Si nous considérons particulièrement le sens et les transformations que Spinoza donne dans la quatrième partie de L’Éthique, l’amitié devient un terme intermédiaire entre l’éthique et le politique, une pratique vertueuse et créatrice.
En effet, de la grande diversité des affections naîtra une grande différence entre les hommes qui les fait entrer dans des conflits mutuels, manière d’être en relation.
La loi du mimétisme affectif et le principe de ressemblance ou de similarité jouent un rôle déterminant dans le processus d’explication des liens qui existent entre les hommes dans la vie communautaire. Si l’homme, par nature, a besoin des hommes pour se faire approuver ou admirer par eux, c’est sans doute aussi parce que l’ambition est à la base de la fondation de la communauté humaine.
Cette analyse de l’ambition révèle que les hommes s’efforcent de faire ce que les autres hommes verront également avec Joie, or Spinoza pose l’existence d’un bien qui serait commun à tous : connaître Dieu. Dieu se constitue à travers l’idée que nous en avons et tous peuvent en jouir pareillement sans dommage pour autrui. La joie que la connaissance de Dieu procure est directement bonne, c’est une jouissance constitutive par laquelle Dieu lui-même s’exprime par l’esprit humain. Dieu se réjouit de sa propre idée dans et à travers l’homme.
Seulement aujourd’hui malheureusement on ne peut pas réellement être ce que l’on voudrait être car on est englués dans une sphère sociale dont on a par ailleurs besoin pour exister.
Ainsi les hommes qui se battent pour leur liberté et leur indépendance doivent reconnaître la nécessité du lien social, de même que leur statut d’unité sociale car toute réalisation personnelle exige une reconnaissance sociale, or le capitalisme et l’esclavage qui perdurent de façon de plus en plus féroce dans notre monde sont tous deux des systèmes rationalistes, rationalisant l’existence pour faire de l’argent, mettant de côté l’humanité en nous, dans un monde dans lequel les hommes n’arrivent pas à se réaliser et qui devient dès lors une prison.
Ainsi le plus grand danger aujourd’hui pour le devenir, il ne vient pas de ceux qui nous gouvernent, simplement parce que les pouvoirs actuels dans le monde dépendent moins du pouvoir de l’État que du marché capitaliste qui détermine un pouvoir de plus en plus diffus, inconscient, qui soumet et organise les différentes subjectivités, qui détermine nos manques et nos besoins…
*Poète, essayiste, dramaturge et peintre
Bibliographie:
[1] Texte écrit à Paris en 1985.

