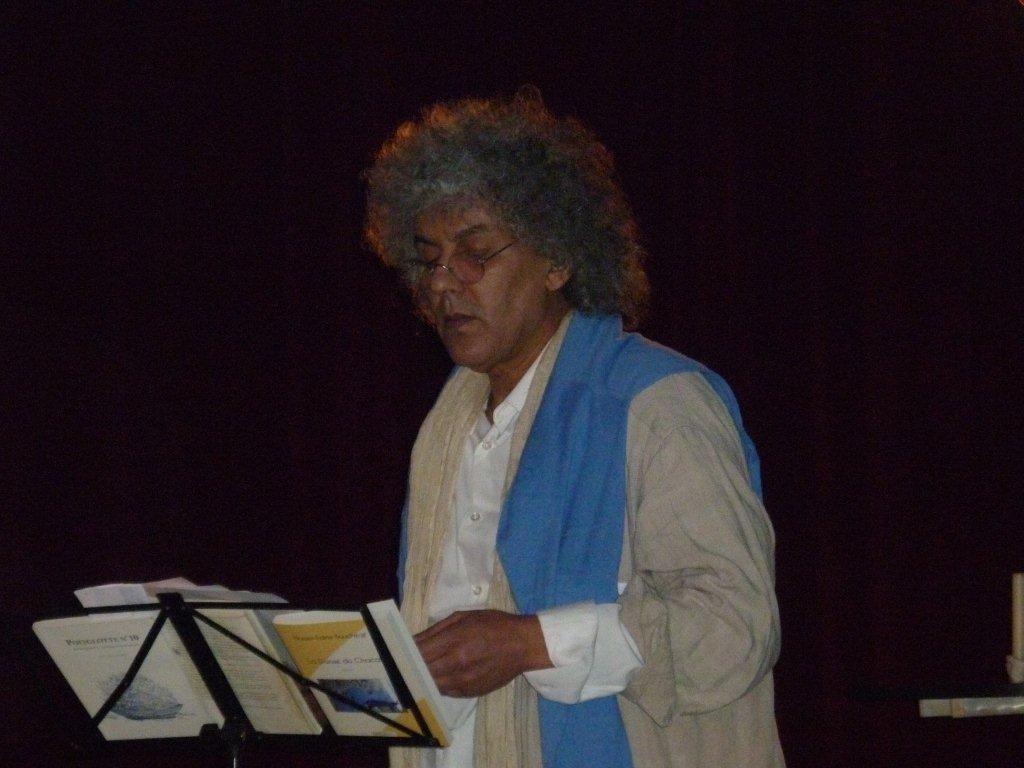
Par Nasser-Edine Boucheqif*

C comme Conscience de soi
(2ème partie)
En effet, nous portons des valeurs affectives profondes aux êtres et aux objets qui nous entourent et leur simple disparition nous donne l’impression d’être amputé d’une partie de nous-mêmes. Plus notre attachement sentimental porté sur les êtres et les choses est profond, plus ils font partie de nous-mêmes, le Mien est alors étroitement lié au Moi.
La multiplicité du Moi et par conséquent de notre comportement nous oblige à conclure à l’impossibilité d’une connaissance juste et réelle de nous-mêmes. Cette incapacité se trouve encore renforcée par la théorie de P. Janet[1] selon laquelle il se forme -dans l’hystérie par exemple- une autre conscience et même une autre personnalité à côté de la conscience personnelle et normale.
Ainsi à cause de l’existence multiple de nos Moi, il nous est impossible de nous connaître ou même de définir notre Moi par une investigation psychologique. Parfois nous nous sentons proche de notre Moi à la suite par exemple d’une attitude que nous avons adoptée et dont nous sommes fiers car elle correspond à notre idéal ou à l’image que nous voulons donner de nous-mêmes, mais nous nous sentons tout aussi éloignés de nous lorsque nous laissons échapper un acte ou une parole qui ne nous ressemble pas ou plus exactement que l’on devine ne pas nous ressembler. Nous cultivons donc une certaine familiarité avec notre Moi et comme l’a écrit M. E. de Montaigne[2] : « si je ne suis chez moi, j’en suis toujours bien près. »
Mais le regard que nous portons sur nous-mêmes n’aboutit jamais à ce que nous sommes et en effet, nous nous rendons vite compte que la proximité établie avec nous-mêmes n’est qu’une illusion, et plus nous voulons entrer en profondeur, plus nous nous heurtons à une incapacité à maîtriser ou à définir notre Moi. G. K. Chesterton[3] nous en rend compte dans sa formule : « le Moi est plus loin de nous que toutes les étoiles ». Le Moi se cherche donc en vain et nous cherchons vainement ce Moi. Le sentiment de vide a inspiré nombre de philosophes, d’écrivains tel B. Pascal[4] qui va même jusqu’à dire que « le Moi est haïssable », car « il y trouve ce qu’il voit », c’est-à-dire la misère et les vicissitudes. Ainsi notre Moi nous échappe dès que nous tentons de l’atteindre car, comme nous l’avons vu, il est multiple. En revanche, tous nos Moi s’unissent avec Je, se retrouvent, s’affermissent.
Contrairement à D. Hume[5] qui, en tant que phénoménologue ne croyait pas en un sujet pur et pour qui le Moi était une succession d’états de la conscience ou d’attitudes, E. Kant affirme que : « le Je pense doit pouvoir accompagner toutes nos représentations ». En effet, nous possédons un sentiment de permanence et tous les Moi que nous possédons sont en quelque sorte reliés par le Je. Ce Je nous apporte comme dirait W. James le sentiment de l’unité fonctionnelle de la conscience et du corps et par ce fait même une possibilité d’introspection de notre Moi profond pour reprendre le terme d’H. Bergson[6]. Avec ce Je nous sommes alors en présence de la conscience réfléchie, ce qui nous offre la possibilité de remettre en question notre Moi, de jouer le Je où la conscience réfléchie établit donc un choix du Moi, c’est-à-dire un choix du comportement à adopter. Ainsi, le Je censure de façon quasi-permanente les premières manifestations du Moi – que nous appelons conscience spontanée – laissant celle-ci dans l’ombre ainsi que tout un aspect du Moi. C. G Jung[7] appelle cette ombre ressentie par l’homme « le côté inconnu, inquiétant de lui-même, comme un être à la fois étranger et apparenté, un alter-égo ». Nous comprendrons comment le Je établit cette censure avec la thèse de S. Freud[8] sur l’inconscient. Mais le fait d’affirmer que la conscience est une unité ne nous éclaire pas sur la nature du Moi, du Je.
Descartes a ainsi franchi un pas de trop en pensant qu’il était possible de connaître l’identité du Je en tant que substance car, dans la mesure où la conscience se rapporte toujours à autre chose qu’à elle-même, qu’elle dépend foncièrement de ce que nous vivons et dans la mesure où le Je n’est pas séparable de son activité, il est impossible de l’identifier en tant que tel.
Ainsi donc, si le Je permet d’unifier toutes nos représentations, nous ne pouvons connaître l’identité même de ce Je ou l’essence de ce que R. Descartes nomme « substance pensante ». Le Je nous permet alors de constater une fois de plus que l’homme est un être inachevé, en perpétuelle évolution, à la fois multiple et inconnu de lui-même.
La découverte de l’inconscient ne fait que renforcer notre sentiment de dépossession par rapport à nous-mêmes car son influence sur la personnalité est primordiale.
Bibliographie:
[1] Pierre Janet (1859-1947), Philosophe, psychologue français.
[2] Michel Eykuem de Montaigne (1533 -1592), philosophe, moraliste catholique et politicien français.
[3] Gilbert Keith Chesterton (1874 -1936), écrivain, essayiste, poète, pamphlétaire et moraliste anglais.
[4] Blaise Pascal (1623-1662), écrivain, mathématicien, philosophe, physicien et théologien.
[5] David Hume (1711-1776), philosophe, historien et économiste écossais, il exerça une grande influence sur E. Kant. Il est également le fondateur de l’Empirisme moderne avec Berkeley et Locke.
[6] Henri Bergson (1859-1941), philosophe français. Auteur de nombreux essais dont : Essai sur les données immédiates de la conscience, Matière et mémoire, L’évolution créatrice, Le rire….
[7] C. G Jung (1875-1961), psychiatre, essayiste et psychothérapeute suisse. Il est le fondateur de la psychologie analytique. Il est également le premier à s’opposer au discours de S. Freud.
[8] Sigmund Freud (1856-1939) neurologue et psychanalyste autrichien dont la théorie a été souvent remise en cause et critiquée parfois de manière violente. Karl Popper voit dans la théorie psychanalytique freudienne ‘une pseudo démarche scientifique’.

