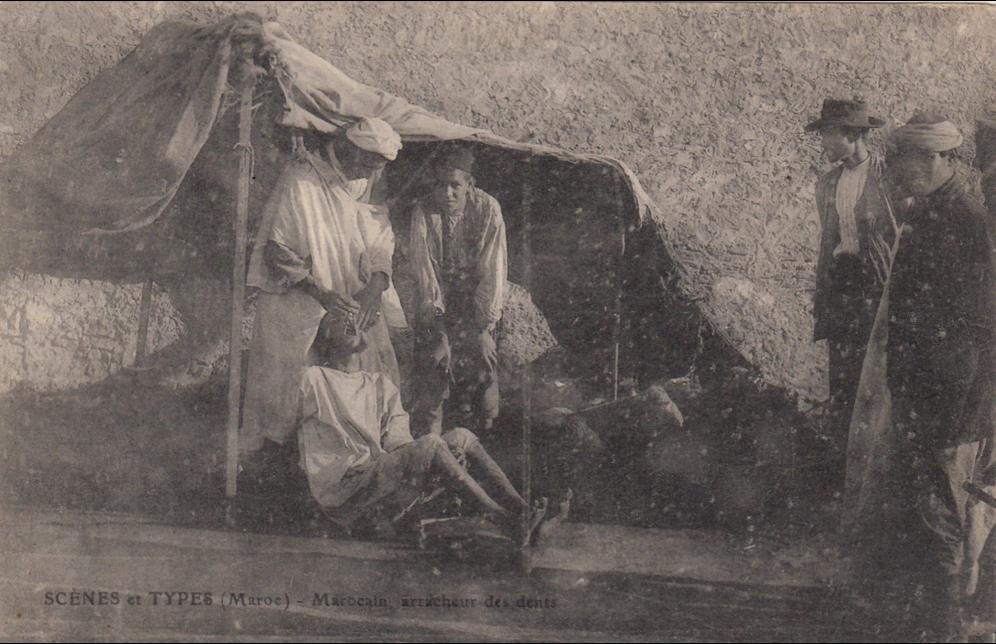Mon frère ravissait son entourage et moi le premier de ses inventions infantiles. La gloire de notre famille était personnifiée en lui. Il savait tout faire — ou presque — Il était en mesure malgré son âge, de trouver une solution à tout problème qui perturberait le train-train familial. Il avait de l’audace et aussi la technicité du savoir-faire manuel. Du vulgaire il créait le magnifique, le curieux, le splendide. Je me demandais toujours où puisait-il ses idées, moi qui n’en trouvais même pas de quoi meubler mon temps vide. Lui, il épatait tout le monde dans la famille et jusqu’aux voisins et amis de grand-père, en qui nous voyions un patriarche rigoureux.
Nous habitions presque à la lisière ouest de la ville. Trois cimetières la bordaient de ce côté: le musulman, le chrétien et le juif. Au-delà la vue était dégagée sur l’immensité des champs dans leur unicité. Seul une route récemment construite pour faciliter la circulation vers la station balnéaire de Saidia, à environ 18 km au nord-est, se plaçait comme un cheveu noir sur cette étendue que ne limitaient que quelques collines lointaines. Un jour printanier, qu’il avait plu toute la nuit, un soleil radieux inonda la petite ville tôt le matin. Une lumière éclatante, presque aveuglante, se déversait sur les champs et faisait miroiter les gouttelettes d’eau restées accrochées à l’herbe.
C’était un vrai délice pour les yeux, un enchantement pour les âmes sensibles aux charmes de la nature, dont nous éprouvons, en ces temps où l’humain l’a saccagée pour son intérêt éphémère, une grande nostalgie. Les coquelicots et les marguerites en massifs spontanés ou éparpillés négligemment sur ce tapis vert en faisaient un magnifique tableau qui se prêtait aux rêves des enfants. Il n’était guère loin, dans sa beauté, de ces images qui s’insinuaient dans notre imagination lorsque nous lisions ces textes littéraires de nos livres de lecture. Le rêveur que j’étais en éprouvait un vif plaisir.
Comme nous le disions dans le temps, ce matin Dieu avait fait prévaloir sa volonté sur celle de mon frère qui préférait n’importe quelle autre tâche plutôt que garder la chèvre de grand-père. Ce jour où un miracle aurait dû se produire. C’était vraiment rare que cela se produisît, ce fut l’une des rares fois où mon frère reçut en partage avec moi, la mission d’emmener la chèvre de grand-père — vestige de sa vie campagnarde— paître dans les jachères alentour. Mon frère se retrouva avec moi en partage de la responsabilité de cette chèvre qui donnait une satisfaction psychologique à notre grand-père et à moi une amertume qui a marqué toute mon enfance. Je le voyais tourbillonner, ondoyant, instable. Il était incapable de se fixer sur une idée ou une chose. Il s’ennuyait ferme. On dit que l’ennui — pratiqué avec modération— serait propice à la créativité. Si l’on juge par ce qui va suivre, on ne peut que souscrire partiellement à cette hypothèse qui n’est pas une évidence. L’herbe encore trempée, le ciel bleu d’azur, les chants des oiseaux qui sillonnaient le ciel, ces insectes qui voltigeaient à la recherche de leur nourriture et plein d’autres miracles vivants ou inertes de la nature et toute cette atmosphère paradisiaque et ensorceleuse le laissait impassible. Rien de tout cela ne put le soustraire au besoin d’être actif qui le rongeait de l’intérieur. Mon frère et moi, nous étions comme deux pôles qui s’excluent et s’éloignent fatalement l’un de l’autre. Notre rencontre était souvent conflictuelle. Il fallait attendre notre jeunesse et puis l’âge adulte pour que cet éloignement de tempéraments se rétrécisse et se mue en une proximité sentimentale teintée d’une grande intimité.
Ce jour, je le vis agité, nerveux, il semblait chercher quelque chose d’indéfini, une occupation qui le soustrayait à cette oisiveté, quoique temporaire. Je ne pus lui demander la raison de son instabilité, de son excitation de faire quelque chose. Je l’observais de loin, tout en gardant un oeil vigilant sur le parcours de la chèvre afin qu’elle ne s’éloigne pas vers les champs environnants cultivés d’orge et de blé. J’étais sûr que je ne recueillerais qu’une rebuffade si je m’aventurais à le questionner à propos de son exaltation de ce matin, alors que moi je me sentais comblé de béatitude et de contentement.
Quelques moments après je le vis accroupi près d’une petite mare boueuse laissée par la pluie récente, les mains farfouillant dans le sol détrempé. Je le vis plonger ses deux mains dans la glaise en ramassa une boule, l’examina, la soupesa. Il chercha autour de lui une grosse pierre plate, dont il se servit comme siège. Il se mit à malaxer sa boule de terre boueuse, sans avoir l’air de savoir qu’en faire au juste. Le malaxage dura un moment. Puis soudain ses yeux brillèrent. Son esprit s’illumina d’une idée qu’il jugea réalisable. Je regardais du côté de la chèvre et je la vis s’approcher du champ de blé voisin. J’accourus, lui fis barrage et la dirigeai vers le centre de cet espèce de bocage que constituait ce vaste champ inculte et dont nous étions ce matin les seuls occupants. Ce vaste champ était une espèce de sas, une antichambre entre le village et la campagne profonde. Il était bordé d’un côté de cet ensemble des trois cimetières qui s’érigeait dans mon imagination comme un poste frontière entre deux mondes totalement différents voire antinomiques: celui des vivants et celui des morts.
D’un autre côté, il y avait l’enceinte qui abritait le souk hebdomadaire. Du troisième côté, s’étendait la route asphaltée toute récente, construite pour desservir la station balnéaire de Saidia en contournant le village. Juste au-delà s’étendaient les champs cultivés. Du quatrième côté, il y avait le chemin de terre qui conduisait vers cette campagne profonde d’où déboulait le lundi et le jeudi, jours de souk hebdomadaire, une masse de ruraux. Après avoir ramené la chèvre au bon endroit, je me suis installé à une distance qui me permettait de surveiller ce qu’entreprenait mon frère. Moi aussi je m’étais donné comme siège une grosse pierre. Puis je me replongeai dans mon imagination tout en bousculant, soit avec un bout de bois, soit avec une petite pierre assez pointue, la flore et la faune du sol autour de moi. De temps en temps, je jetai des regards interrogateurs vers lui, poussé par la curiosité qui poignit en moi dès que j’ai vu mon frère commencer à s’affairer avec obstination à triturer la boule de glaise qu’il avait ramassée. Il avait l’air apaisé et absorbé par son occupation. Je m’approchais de lui et le vis en train de sculpter une petite forme rectangulaire à l’aide d’un petit morceau de métal qu’il avait déniché sur le sol autour de lui. Il ne fit pas attention à moi et continua d’harmoniser les parties de cette terre qu’il avait ramassée auparavant. Je ne pus me permettre, tant par fierté personnelle que par peur qu’il me renvoie par une rebuffade à ma charge de berger d’une seule chèvre. Ma susceptibilité et mon orgueil ne pouvaient supporter un tel affront. Nous nous aimions — Il était, après grand-père, mon protecteur— mais nous nous ne supportions pas beaucoup. L’âge avait finalement remédié, comme je le disais, à cette mixité d’amour et de répulsion. Je le regardais faire. Un œil sur ses doigts moulant la patte de terre et qui s’agitaient dans une harmonie impeccable et l’autre sur la chèvre dont l’instabilité naturelle me paraissait volontaire et même préméditée de sa part pour me contrarier, pour me fatiguer à lui courir après. Je me méfiais beaucoup de cet animal de la race caprine dont on disait, d’ailleurs à raison, qu’il avait la bougeotte. Je gardais encore en mémoire son échappée avec d’autres chèvres appartenant aux voisins, qui avait coûté une amande à grand-père pour la faire sortir de la fourrière où elles avaient toutes été emmenées. Ce fut pendant l’été précédent. Nous étions une petite troupe mixte — trois ou quatre garçons et deux filles— nous associions nos chèvres et nous les gardions ensemble. A plusieurs la tâche nous paraissait facile. A contrario, la responsabilité était diffuse.
C’était la période où le jujubier sauvage donne généreusement son fruit et comme tous les enfants nous en étions friands. Nous nous déplacions d’un jujubier à un autre, comme des abeilles d’une fleur à une autre, sans se soucier de notre troupeau caprin. Quand nous-mêmes fûmes rassasiés de jujubes, nous pensions à nos chèvres. A notre grande amertume, nous constations que nos chèvres n’étaient plus en vue. Nous parcourions chacun dans une direction tous les environs, cependant en vain. Il ne nous restait que d’accepter, avec accablement et peur au ventre de la punition parentale, l’échec de nos recherches et le résultat de notre conduite négligente. Nous rentrâmes chez-nous. Nos parents comprirent que les chèvres ne pouvaient être qu’à la fourrière. Ils se concertèrent et partirent payer l’amende pour récupérer leurs biens. Pendant que nous nous régalions de jujubes mûrs à point sans la moindre attention au temps qui passait, les chèvres profitant de ce relâchement de vigilance se jetèrent dans un champ de blé pour s’en régaler goulûment à leur tour. Mon frère tout à sa passion ne s’était aperçu de ma présence à sa proximité qu’après un long moment. Il me découvrit comme un premier juge de sa réalisation. Alors, il tendit, vers moi, ses deux mains tenant cette chose en terre qui commençait à prendre une forme rectangulaire qui me paraissait revêtir une certaine beauté, puis me dit avec un sourire de satisfaction: « Regarde, je suis en train de fabriquer une radio en terre, c’est bientôt fini… ». Il continua sa besogne sous mes yeux ébahis et je le vois encore, à travers mes souvenirs, grimacer de ses lèvres pour suivre le mouvement de ses mains qui travaillaient, je me dois de le dire, habilement la pâte. Un moment passa et comme un magicien qui sort de son chapeau ce qu’il prétend être le fruit de sa magie, il me tendit cette œuvre qui l’avait soustrait de ce monde pendant un laps de temps et me dit: « Regarde ! Ne ressemble-t-elle pas à notre radio? Attends, il lui manque l’aiguille qui marque les stations… ». Il fouilla autour de lui comme s’il était dans son propre atelier, récupéra une fine brindille de paille, d’à peu près un deux centimètres, jaunie par le soleil et la plaça délicatement derrière ce qu’il avait conçu comme une plaque de verre barrant horizontalement sa petite radio, censée indiquer les noms des stations. Quand il eut fini, il consentit, les yeux brillant de fierté et de contentement, de me la mettre entre les mains pour l’examiner à loisir et évidemment donner mon avis, qu’il attendait certainement réconfortant son contentement et son bonheur. Son espoir placé en mon avis ne fut pas déçu.
Je fus émerveillé, épaté, fasciné par sa réalisation. Effectivement j’y voyais une minuscule réplique en terre de notre radio. Elle avait tous les attributs du poste à lampes radio dont disposait grand-père dans sa boutique, qu’il écoutait religieusement et assidument tous les matins à huit heures pour s’informer surtout des activités royales. Une fois les nouvelles terminées, il l’éteignit et le couvrit soigneusement d’une serviette à rayures rouges. Mon frère et moi — lui plus que moi– nous avions le droit de l’écouter lorsque nous prenions alternativement son relais dans la boutique, à condition de baisser le volume et qu’il n’y ait un quelconque client d’un certain âge. Par pudeur, celle que nous imposait une culture trop restrictive, dès que grand-père mettait le pied dans la boutique nous l’éteignîmes. Chanter ou même écouter des chansons en présence d’une personne, dont nous reconnaissions l’ascendance était un manque de respect flagrant.
Je regardais ce poste radio de terre minuscule avec une admiration mélangée d’auto-déception. Je ne jalousais pas mon frère parce que j’avais intégré, à mon corps défendant, dans ma conduite ma reconnaissance de la supériorité de son physique et surtout de son esprit pratique. J’ambitionnais d’être comme lui et en même temps je me persuadais qu’une telle perspective était hors de ma portée. Je me contentais et plus, je me rabattais sur les bons résultats que je réalisais à l’école. Il ne se passait guère un jour sans qu’il ait une quelconque idée qui confirmait à mes yeux sa supériorité. C’était lui qui fabriquait des charrettes montées sur trois roulements de billes — dont il vendit quelques unes— qu’on utilisait pour organiser des courses de vitesse dans les rues désertes de la ville.
A l’époque le passage d’un véhicule automobile était presque un événement insolite à ne pas rater. C’est aussi lui qui montait des théâtres d’ombres auxquels assistaient les enfants du voisinage moyennant des bouts de craie, des billes de jeux, ou tout autre objet qu’il jugeait utile. Un jour il eut l’idée généreuse d’offrir à notre petit frère dernier à l’époque, d’environ deux ans, un jouet. Il fabriqua un petit chariot qu’il monta sur deux petits roulements à billes et l’attela au chat de la maison. Celui-ci mi-sauvage, se sauva affolé par l’étrange accoutrement dont il l’affubla. Il courut dans tous les sens en heurtant tout ce se trouvait son chemin et poussant des miaulements déchirants de colère et de détresse. Le petit chariot fut complètement disloqué et le chat renia notre maison durant plusieurs jours.
Sans malice je le complimentai avec effusion sur sa réalisation. Il se montra satisfait du temps passé à faire paître la chèvre et probablement pour cueillir d’autres compliments de la famille, il me signifia qu’il était temps de rentrer à la maison. Je courus chercher avec plaisir la chèvre et la dirigeai sur le chemin du retour à la maison. C’est grand-père qui eut la primauté d’apprécier la nouvelle innovation de son petit-fils ingénieux et de s’en enthousiasmer. Ensuite elle fit le tour de tous les membres de la famille. Même les absents de la journée purent la contempler à leur retour. Mon frère fut noyé dans les émerveillements et compliments unanimes et son admiration en fut autant accrue. Grand-père n’entendit pas restreindre le bénéfice d’apprécier la merveille aux seuls membres de la famille. Il s’empara notoirement et péremptoirement de la dernière création de son petit-fils et l’installa tel un trophée prestigieux sur le vrai poste radio à la portée de vue de tous. Elle eut pendant plusieurs jours le statut d’une curiosité digne de tous les égards et tous les soins. Grand-père ne manquait jamais de prétexte pour exhiber la réplique en terre de son poste radio à l’admiration de ses amis clients qui s’agglutinaient dans la boutique autour de lui entre les heures de prières. Les enchantements, réels ou simulés ne manquaient pas. Ce qui rendait la réussite de l’entreprise de mon frère totale et incontestable et de ce fait lui donna l’étoffe d’un chef-d’œuvre. La satisfaction de grand-père de son petit-fils en fut débordante et la fierté de mon frère atteignit sa limite supérieure. Il m’arrivait, je dois le reconnaitre, de sentir, à tort ou à raison, un tintement d’arrogance dans l’attitude de mon frère. Pour éviter le dommage émotionnel que ce sentiment produirait sur moi, je me réfugiais dans l’idée, adoucissante de cet impact, de me convaincre de mon désintéressement total et justifié de tout ce qui est manuel. Ce ne fut peut-être qu’un baume, à effet éphémère, appliquée à une blessure narcissique qui m’avait poursuivi jusqu’à ce que j’eusse atteint un âge où le Moi prît l’envergure d’un régulateur.