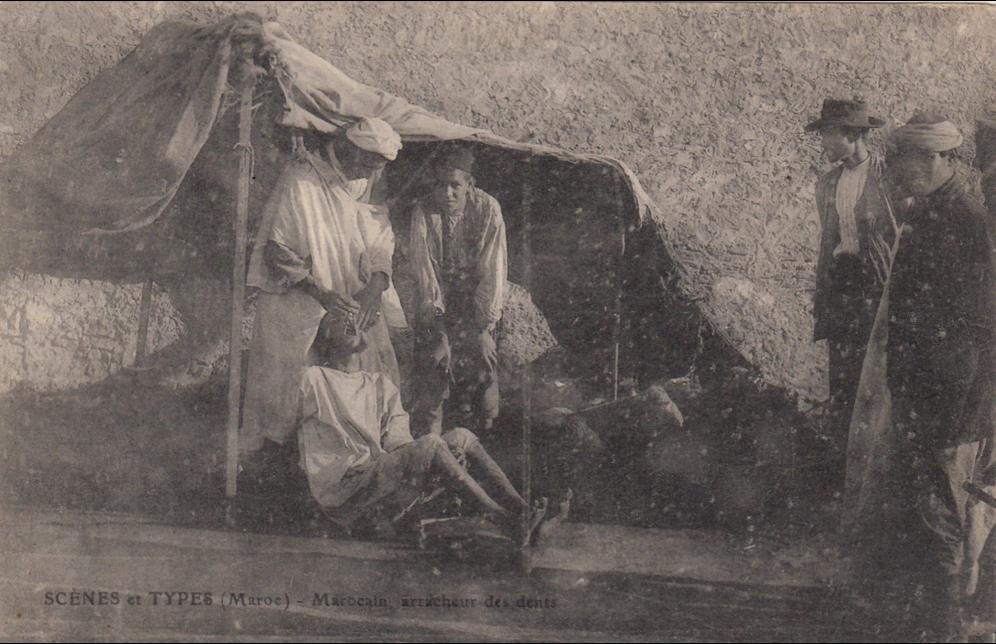A l’époque de mon enfance consciente, le temps s’écoulait doucement et lentement. Il suivait le rythme de vie simple et presque vide des habitants de notre petite ville. Puisque justement il était peu occupé, il paraissait plus long. Dans notre chère petite ville désespérément coincée dans son isolement, le temps donnait l’impression de s’arrêter, de durer et pourtant il passait. Il suivait sa marche inexorable. L’absence d’une personne pendant une ou deux années semblait frôler l’éternité. La pauvreté des moyens de communications accentuait le sentiment de séparation. Le courrier postal, avait une existence qui remontait à l’installation du protectorat français sur l’ensemble du Maroc. Néanmoins faute d’une alphabétisation suffisante de la population —moins de 10% des habitants savaient lire et écrire—, il ne jouait qu’un rôle mineur dans le système de communication. Il était tellement long que l’arrivée d’une lettre était en soi un événement que l’on se hâtait d’ébruiter parmi les proches. Le téléphone était encore un luxe tellement cher et hors de portée que les gens ne pensaient guère à son existence. Les foyers qui en disposaient, en dehors de la poste et de quelques administrations, se comptaient sur les doigts d’une seule main. Je doute fort que la ligne téléphonique était directe. Il fallait, surement, passer par le standardiste pour obtenir le numéro sollicité.
Je devais avoir une dizaine d’années quand mon grand-père maternel, que ses prétentions de se mêler de politique lui avaient valu d’être arrêté arbitrairement et torturé presque à mort, avait subi ce que l’on ne pouvait désigner que de rafistolage à l’hôpital. Il habitait dans une autre ville à une vingtaine de km de la nôtre. Ma mère, qui s’en inquiétait éminemment, ne pouvait, pour des raisons multiples et diverses, se permettre de lui rendre souvent visite, eut l’idée de s’enquérir de ses nouvelles par téléphone. Son frère, un enseignant, qui habitait la même ville que leur père et qui avait ses entrées dans les rouages administratifs de sa ville disposait de ce dispositif qui permet de raccourcir les distances au point de pouvoir se parler, il avait le téléphone. Et c’était sur ses conseils que ma mère un jour usa de tout son courage et demanda à mon père de lui laisser, avant de partir à son travail, le prix d’une communication téléphonique par le bais de la poste bien évidemment. Il s’en fallut de la sollicitation et des arguments convaincants pour qu’elle puisse obtenir satisfaction. Puisqu’il était catégoriquement impensable qu’elle s’en occupât elle-même ; Seules deux sorties étaient autorisées pour une femme : la première quand elle quittait la maison des parents pour rejoindre celle de son mari et la seconde quand elle sortait les pieds devant pour rejoindre sa tombe. Néanmoins la tradition dans sa grande indulgence et évolution par rapport à l’époque de nos parents, lui permettait du temps de notre enfance quelques dérogations à la rigueur de ses lois. Elle pouvait avec l’autorisation expresse du mari et l’accompagnement d’un membre mâle ou femelle de la famille aller visiter ses proches qui habitaient à proximité, se rendre à l’hôpital ou aux mausolées des saints de grande notoriété posthume dans la région quand le mal dont elle souffrait s’aggrave, se recueillir sur les tombes des défunts de la famille, quoique cette dernière facilité n’était pas d’une évidence totale.
Ma mère était illettrée, n’avait de toute sa vie jamais vu, ni su ce qu’était une poste, ni tenu un appareil téléphonique dans la main. Il était manifeste qu’elle devait recourir au service de l’un de ses deux garçons. Elle aurait indubitablement porté son choix sur mon frère. N’était-il pas la coqueluche de la famille ? Beaucoup de responsabilités reposaient sur ses épaules de garçon éveillé et débrouillard. Mais il était ce matin hors de sa portée et elle ne pouvait attendre son retour. L’affaire urgeait car il y allait de la santé de son père et elle s’en inquiétait énormément. Ipso facto elle me confia la responsabilité. Pas plus qu’elle je n’avais eu l’opportunité heureuse de tenir dans mes mains un combiné téléphonique et je n’allais pas encore au cinéma, ce qui aurait pu être une occasion pour moi de voir, en regardant un film, comment procéder pour utiliser le téléphone.
J’allais vers l’aventure. Il n’était pas question de refuser ou de s’esquiver sous quelque prétexte que ce fût. J’avais la trouille, mais je ne pouvais avouer que je ne savais pas me servir du téléphone — elle se serait demandé à quoi me servait ce que j’apprenais à l’école ? Comment l’aurais-je pu alors que dans mon attitude de rivalité avec mon frère, je me prenais pour quelqu’un qui n’ignorais rien des arcanes de la vie moderne. Et puis je ne pouvais souffrir d’offrir une occasion en or à mon frère, que je pensais qu’il s’y connaissait en tout, de me ridiculiser à loisir et à chaque fois que nos relations prennent la tournure d’un différend ou d’une simple opposition à propos de n’importe quoi ? Ce fut la première fois, si je réussissais cet exploit, que j’inscrirais un haut fait technique à côté de mes excellents résultats à l’école sur mon tableau de chasse. Et ce fut, aussi, la première fois que j’allais faire face à une aventure qui m’élèverait ou me rabaisserait aux yeux de tous les membres de ma famille. Un défi que je me lançais ! Ce fut la première fois que j’allais tenir un combiné téléphonique à la main et m’en servir. Alors je me demandais comment j’allais m’y prendre pour m’en sortir. Ma mère me remit les deux dirhams —une fortune pour l’époque et pour un budget comme le nôtre— que je serrais dans la paume de main enfouie dans ma poche et je partis vers l’inconnu.
L’espace où se concentrait les quelques services administratifs de la ville se trouvait à l’extrémité est de la principale et prestigieuse artère qui jusqu’à aujourd’hui porte le nom de Mohammed V (le roi sous le règne duquel le Maroc avait reconquis son indépendance). Quelques centaines de mètres plus loin de ce boulevard pérennisant le souvenir du roi libérateur du pays, en traversant quelques vergers exploités encore à l’époque par des anciens colons, se trouve le tracé de la frontière avec l’Algérie, matérialisée par le cours d’une rivière qui porte le nom de Kiss. C’est probablement cette opportunité géographique qui avait dicté, du temps du protectorat, le choix d’installer la poste, les douanes, le commissariat de police, les bureaux de l’autorité administrative et même l’Eglise à cet endroit de la ville. L’indépendance n’avait apporté aucun changement notable à la configuration de la ville. Il fallait attendre plusieurs années plus tard pour que la ville change complètement de visage et de structure. Le bureau de poste avec sa construction moderne élevée vraisemblablement peu d’années avant le départ du colonisateur ou peut-être dans l’euphorie du recouvrement de l’indépendance, se distinguait notoirement des édifices vieillots qui abritaient les autres services publics.
La peur est parfois bonne conseillère. A peine avais-je entamé le parcours qui me séparait du bureau de poste, j’eus une idée que je pensai être salutaire. Je me suis souvenu que l’un des trois commerçants grossistes de l’alimentaire, au cœur de la ville, auprès desquels mon grand-père, commerçant de quartier dans le même secteur, s’approvisionnait avait le téléphone. Il m’arrivait, en effet, de l’accompagner pour l’aider à pousser la charrette pleine de marchandises. Je trouvai l’idée géniale et j’entrepris de faire le détour par le centre-ville avec l’espoir tendrement caressé et en priant secrètement Dieu de faire sonner le téléphone au moment exact — ce n’était pas peu demandé à Dieu— où j’arrivais en face du magasin alimentaire pour que je puisse voir comment on s’y prend pour l’utiliser. Cette idée que je trouvais plausible ne me rassura guère et la peur d’échouer ou de me faire la honte de demander à autrui comment utiliser le téléphone me tordait les boyaux. Ma volonté resta inébranlable et je poursuivis la quête d’un savoir faire peu répandu dans notre commune. Arrivé en face du fameux magasin, je pris le point le plus stratégique pour observer les manœuvres du personnel autour de l’appareil téléphonique. Mon espoir diminuait au rythme du temps qui passait. Puis sa courbe prenait une ascension vigoureuse chaque fois que quelqu’un s’approchait de l’appareil noir presque en forme de croix juché sur un petit meuble à proximité de la caisse que tenait le patron du magasin. Je ne sais plus combien de temps je dus attendre la sonnerie salvatrice. D’ailleurs, le temps n’avait que peu d’importance au point que nous ne le mesurions que pour satisfaire à l’obligation de fréquenter l’école. L’ange sauveur ne fit pas sonner le téléphone et il me parut que j’étais momentanément abandonné de Dieu. Las d’attendre et craignant que l’impatience s’empare de ma mère et dépité de ce mektoub, je me dirigeai vers le bureau de poste, résigné à subir les événements tels qu’ils allaient se présenter.
J’avais déjà à quelques rares occasions accompagné un membre de ma famille à ce bureau pour poster une lettre après avoir acheté un timbre auprès des agents qui se tenaient derrière un comptoir qui leur conférait, à mes yeux et aux yeux de tous les habitants de la ville une autorité certaine. Certes non équivalente à celle des agents du makhzen, mais leur attribuant assurément un haut rang dans la hiérarchie sociale telle que conçue et acceptée dans notre ville. Les personnes lambda ne se courbaient pas quand ils les croisaient dans la rue, comme ils le faisaient en saluant les représentants du makhzen, mais tout de même ils les saluaient avec un profond respect. Par conséquent, pour ce qui était des démarches à accomplir, je ne me faisais aucun souci. Il me fallait juste exprimer mon souhait auprès de l’un des deux agents qui trônaient royalement derrière le comptoir, en s’activant avec fierté et même suffisance, teintée d’un soupçon de mépris pour les usagers de leur bureau de poste. Ils se prenaient vraiment pour des manipulateurs de génie d’une technologie moderne hors de portée des masses qui sollicitaient leur savoir-faire.
Timidement et en lui tendant le précieux bout de papier sur lequel était inscrit le numéro de mon oncle et les deux dirhams que je sentais humectés de sueur à force de les avoir serrés dans ma main enfouie dans ma poche, je m’adressais au plus jeune des deux préposés: « Je voudrais téléphoner à mon oncle, voici le numéro… ». Il prit le papier et me répondit hautainement, « Garde ton argent tu paieras à la fin, c’est bon va t’asseoir ! » Je suivis peureusement la consigne et pris place sur un banc que la succession quasiment infinie des fesses qui s’y étaient frottées avait rongé la couche supérieur de son bois. Quelques individus me regardèrent avec presque de l’étonnement; on ne voyait presque pas des garnements seuls dans un bureau de service public. Ils me dévisageaient certainement pour pouvoir me situer dans la grille des familles. Tout le monde connaissait tout le monde et on ne pouvait rien faire discrètement. Mes yeux un peu effarés ne cessaient de suivre les gestes et déplacements des deux agents. De temps en temps un monsieur plus âgé que les deux employés, un peu bien en chair, lunettes sur le nez et cigarette au bec faisait des allers et retours entre les agents du comptoir et un bureau escamoté derrière une armoire métallique pleine de registres. Il leur chuchotait et ils lui répondaient tout aussi sur le ton du murmure. Ils avaient l’air de lui témoigner fort respect. Je conclus que c’était leur directeur, car je m’étais souvenu de l’attitude qu’observaient mes maîtres d’écoles quand ils recevaient le directeur. Je vis aussi le jeune auquel je m’étais adressé, de temps en temps, s’approcher d’une grosse caisse de bois installée, en contrebas, devant lui et portant sur le dessus plusieurs boutons qui n’arrêtaient pas de s’allumer et s’éteindre et des interrupteurs qui ressemblaient, en plus petit, aux interrupteurs d’électricité dans notre maison et qu’il maniait avec ses doigts. Il les actionnait après avoir mis de part et d’autre de sa tête sur ses oreilles ce que longtemps plus tard je sus que c’était un casque. Etourdi par autant de nouveautés, je n’eus pas l’idée de me demander ce qu’il pouvait y entendre. J’étais émerveillé, j’étais sorti de mon petit univers où la chose la plus moderne était la radio que grand-père écoutait dans sa boutique. J’étais fasciné par tant de modernité technologique qui s’étalait à ma vue, il y avait même plaquée au mur une grosse horloge, dont les aiguilles décomptait le temps dans son écoulement souverain et bien d’autres choses dont je ne connaissais pas l’usage. Si j’étais mort ce jour là j’aurais été content que mes jours se terminent par la découverte de ce prodigieux essor technologique.
La peur de ne pas savoir utiliser l’appareil téléphonique me relança. J’étais désemparé, presque terrorisé. Je regardai autour de moi à la recherche d’un éventuel secours et mon regard se posa opportunément sur l’unique cabine téléphonique du bureau de poste. J’espérais y voir quelqu’un en train de téléphoner pour le copier, en vain. Elle était désespérément vide. Je continuai à nourrir l’espoir que quelqu’un serait venu avant moi pour la même raison et qu’il allait m’y précéder. Mon espoir s’évapora instantanément quand j’entendis le jeune agent dire à voix assez haute: « Téléphone pour Berkane, vas y entre dans la cabine… ». Je me souviens encore et nettement de ce bondissement que fit mon cœur, j’imagine que ma chemise se soulevait visiblement au niveau de la partie gauche de ma poitrine. Je tremblai presque. J’étais perdu, mais j’avais rassemblé tout ce que j’avais comme courage pour faire face, vaillamment, à cette adversité à la quelle je voulus m’exposer tout en la redoutant énormément. Je pénétrai alors dans la cabine. Elle sentait des relents de transpiration que la chaleur avait amplifiée. Un bloc noir surmonté du combiné était là accroché au mur. Sa vue me renvoya le souvenir des gros corbeaux noirs que je voyais dans la campagne quand j’y allais passer quelques jours chez mes grands parents maternels lorsqu’ils y habitaient encore. Craintivement je tendis ma main, soulevai délicatement le gros et lourd combiné, mais je ne sus laquelle des deux extrémités de cet engin mystérieux mettre à l’oreille et laquelle utiliser pour parler. Je le tenais horizontalement et mon hésitation dura quelques secondes sans que je puisse me décider. Soudain j’entendis une voix faible venant de loin sortir de l’un des deux bouts. Alors, mon esprit s’illumina, mon visage devait retrouver sa couleur et mon cœur ralentir ses bondissements. Je collai cette extrémité d’où sortait la voix magique à mon oreille et l’autre s’ajusta automatiquement au niveau de ma bouche. Une voix féminine me questionna sur mon identité. Je la déclinai et transmis le message de ma mère. C’était ma tante, l’épouse de mon oncle. Comme le veut l’habitude qui impose ses règles de politesse même si le message à délivrer est catastrophique, elle s’enquit d’abord des nouvelles de ma mère et de tous les membres de la famille, puis en essayant de donner autant que possible crédit à ses paroles, elle me demanda de dire à ma maman que son père se portait de mieux en mieux et qu’il avait même commencé à se nourrir. Je reposai le combiné tout aussi délicatement que lorsque je l’avais soulevé et sortis de cet espèce d’isoloir. Je sentis que j’avais les joues en feu et le sourire illuminé.
L’épreuve fut réussie. Je payai la communication et quittai le bureau de poste. J’étais aux anges, je riais fort, j’étais fier de moi, de mon exploit, j’aurais voulu que le monde entier le sache. Dans la rue je courais et je faisais des gambades de joie. Voilà un point de marqué dans le match perpétuel qui m’opposait à mon frère et aussi à moi-même, car je me sous-estimais et me voyais d’une incapacité incurable et désespérante par rapport à lui. Je n’avais pas manqué de raconter mon exploit à qui voulait m’entendre. La fierté de soi élève et donne les moyens psychiques pour frayer son chemin dans cette vie que beaucoup de tares sociales compliquent.