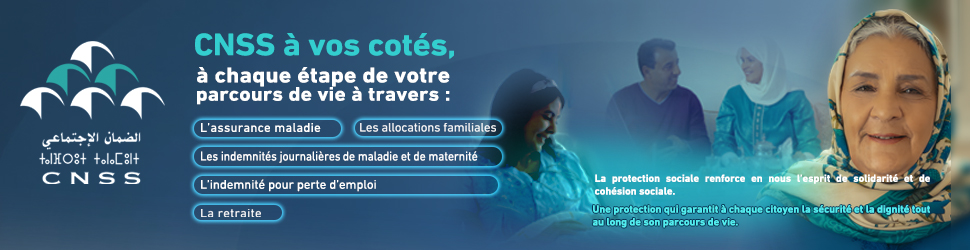Paris, de notre correspondante Zakia Laaroussi
Dans un article publié récemment dans le Wall Street Journal, Marco Rubio, secrétaire d’État américain, esquisse les nouvelles lignes de force de la diplomatie américaine. Ses premières visites officielles se concentreront sur des pays d’Amérique centrale tels que le Panama, le Costa Rica, le Guatemala et la République dominicaine. Ce choix est révélateur : ces États, alliés naturels des États-Unis, entretiennent également des relations étroites avec le Maroc et soutiennent sans ambages son intégrité territoriale.
À l’opposé, Rubio ne ménage pas ses critiques envers les régimes hostiles au Maroc en Amérique latine, notamment le Venezuela et Cuba, bastions idéologiques de l’Algérie, qui s’évertuent à contester la souveraineté marocaine. Cette démarcation nette s’inscrit dans une politique de recentrage des alliances américaines vers des partenaires stables, crédibles et engagés dans une dynamique de coopération constructive.
Et ce n’est pas tout. L’Afrique du Sud, autre allié du régime algérien, est désormais dans le collimateur de l’administration Trump. Pas plus tard qu’hier jeudi, Marco Rubio a fait savoir qu’il ne participerait pas à la réunion du G20 rassemblant les ministres des affaires étrangères, les 20 et 21 février à Johannesburg. Ce boycott est consécutif aux accusations de Donald Trump d’une confiscation des terres des paysans blancs en Afrique du Sud.
Une convergence d’intérêts entre Rabat et Washington
Les choix diplomatiques de l’administration américaine traduisent une harmonisation quasi-parfaite avec les intérêts stratégiques du Maroc. Les pays mentionnés par Marco Rubio – le Costa Rica, le Guatemala, ou encore la République dominicaine – ne sont pas seulement des partenaires fiables pour les États-Unis ; ils partagent également avec Rabat une vision commune fondée sur la stabilité et la prospérité régionale.
En revanche, les adversaires du Maroc, tels que l’Algérie, se retrouvent de plus en plus isolés sur la scène internationale. Leur soutien inconditionnel à la milice séparatiste du « polisario » et leur politique de confrontation apparaissent désormais anachroniques face aux nouvelles réalités diplomatiques. Le discours de Rubio, bien que mesuré, envoie un signal sans équivoque : les temps changent, et les vents de l’Histoire soufflent en faveur du Maroc.
Le Maroc : acteur clé et pilier de la stabilité régionale
Depuis la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara en décembre 2020, la donne diplomatique s’est profondément transformée. Ce soutien, qui a fait office de catalyseur, a encouragé plusieurs nations à réévaluer leurs positions sur le dossier saharien. Le Maroc, fort de cette légitimité internationale, s’affirme désormais comme un acteur incontournable du jeu régional.
En première ligne dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement – thèmes abordés dans l’analyse de Rubio – le royaume chérifien est devenu un modèle de stabilité et de développement en Afrique du Nord.
Dans cet univers où rien n’est fortuit, chaque geste diplomatique est porteur d’une signification profonde. L’alliance entre Rabat et Washington n’est pas un simple alignement de circonstance : elle repose sur des intérêts convergents et une vision commune de l’avenir. L’appui sans équivoque des États-Unis à la marocanité du Sahara confirme cette réalité : le Maroc est bien plus qu’un partenaire parmi d’autres. Il est un allié stratégique, un acteur central dans la recomposition des équilibres régionaux et un symbole de cette diplomatie du pragmatisme intelligent.
Les récentes déclarations de Marco Rubio ne laissent d’ailleurs aucun doute à ce sujet : le Maroc, fort du soutien de ses alliés, avance avec assurance, porté par des vents diplomatiques favorables et conforté dans sa position de puissance régionale montante.