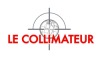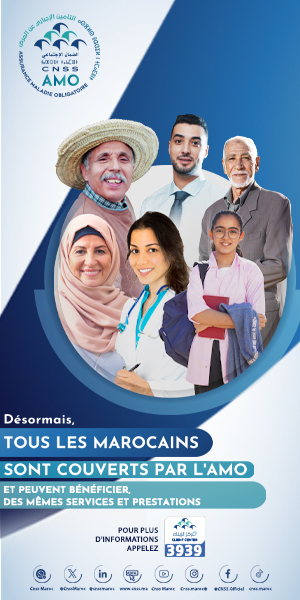Par Nasser-Edine Boucheqif*

Ainsi, J. Racine[1], qui fut sans doute complètement bouleversé par le côté dévastateur de l’amour, par la passion qui rend fou, créa dans Phèdre des personnages divers ayant tous une conception différente de l’amour, mais auquel pourtant, aucun ne put échapper.
Tous les héros de cette tragédie[2] tombent amoureux, Thésée qui est prêt à franchir tous les dangers pour de nouvelles conquêtes, Aricie qui méprise les amours faciles mais qui se trouve irrésistiblement attiré par un cœur qui se rebelle, Hippolyte qui considérait l’amour comme une faiblesse ne put échapper à celui qu’il éprouva pour Aricie et Phèdre surtout, que l’amour rendra jalouse et cruelle.
Ces personnages rendus réels, matériels (même s’ils sont fictifs) incarnent ainsi la passion sous tous ses aspects, ils sont la concrétisation de sa force dévastatrice qui sera fatale à Phèdre mais aussi à l’auteur de la pièce lui-même.
Il en est de même pour la peinture : l’artiste, lui, donne un sens humain à la nature, il rend visible des sentiments qui ne l’étaient pas, qui ne faisaient partie que de son monde personnel et intérieur.
Ainsi, V. Van Gogh[3], dans « Les oliviers à Saint-Rémy » prête un caractère humain à des arbres ordinaires. La torture intérieure de l’artiste est représentée de façon réelle, visible à tous par des oliviers auxquels il donne une forme à la fois tordue et houleuse. Il n’y a plus aucun rapport entre les oliviers de Provence que l’on pourrait voir sur une carte postale et ceux peints par Van Gogh.
Ici, il ne s’agit plus de savoir si la nature ne doit pas être représentée. L’artiste va la chercher plutôt qu’il ne la copie -quand elle se présente à lui, « la nature n’est qu’un dictionnaire[4] ». On comprend alors le caractère vain des argumentations au sujet de la relation entre l’art et le réel.
L’idéal artistique si on peut l’appeler ainsi serait, en fait, une synthèse entre le monde réel et celui de l’auteur. Il me semble que cette harmonie a été réalisée entre autres par C. Baudelaire.
En effet, cet artiste est à mi-chemin entre l’imaginaire et le réel, il ne renie pas la nature mais refuse également de se perdre complètement dans un monde intérieur de sensations.
Dans Tableaux parisiens, C. Baudelaire nous donne sa vision de la ville qui renferme à la fois le mal et la magie. Son œuvre est le symbole même de la révolte contre le monde.
Dans son poème Paysage par exemple, il lutte contre le présent, le « fuyant », les saisons qui passent. Quand vient l’hiver, il s’enferme et fait resurgir à lui les images de la beauté. Il contemple la rue et se réfugie en même temps dans un rêve :
« Et quand viendra l’hiver aux neiges monotones/
Je fermerai partout portières et volets/
Pour bâtir dans la nuit mes féérique palais/
Alors je rêverai des horizons bleuâtres/
Des jardins, des jets d’eau pleurant dans les albâtres.[5] ».
Le charbon de la ville rejoint le ciel, tout se mélange, réalité et imaginaire. Ainsi le monde avec le poète C. Baudelaire, perd son absurdité. Il se méfie des naturalistes qui mettent de côté leur imagination et leurs sentiments abolissant ainsi le côté original de l’œuvre. Pour lui, ce ne sont pas de grands artistes. Ils savent peindre, ils possèdent même une technique parfaite mais cela ne saurait suffire. De Gustave Courbet[6], il dira par exemple « qu’il peint mieux qu’il ne s’explique ».
Le tableau de P. Gauguin[7] intitulé « Bonjour monsieur Gauguin ! », répond au réalisme de Gustave Courbet en créant des personnages plats, sans volume, qui se détachent d’un fond sans profondeur, déformant ainsi les corps, la lumière, le paysage mêlant l’imaginaire à la nature. Pour Charles Baudelaire, « l’art est comme une magie suggestive contenant à la fois l’objet et le sujet, le monde extérieur à l’artiste et l’artiste lui-même[8]. »
Dans Curiosité esthétique il nous explique que le génie d’une grande œuvre d’art réside dans la façon que l’artiste a de contempler la nature et dans son pouvoir de recréer un monde dans lequel une grande partie de son être original prend vie.
De cette façon, l’artiste-peintre rompt le côté étranger des choses et des êtres, il leur donne une valeur qui parvient à mettre en accord les deux mondes dans lesquels il est sans cesse déchiré. « Il y a une manière lyrique de sentir[9] ». L’imagination rassemble les outils que la nature met à disposition, elle crée, elle change, elle se révolte tout entière contre son état absurde.
Il est donc vain de défendre fermement une opinion trop « extrémiste » sur les rapports de l’art et du réel dans la mesure où, comme nous l’avons vu, il est tout aussi impossible de reproduire fidèlement la nature que d’en abstraire la présence.
Une œuvre est avant tout nuances et harmonie et vouloir la soumettre à des règles, c’est en quelque sorte en nier le caractère artistique et original. Il s’agit d’établir une dose exacte entre l’imaginaire et le réel pour que l’art puisse atteindre un équilibre parfait entre le trop de lourdeur du réalisme ou la légèreté, voire l’absence de l’abstrait.
Mais en instaurant ainsi un nouveau critère qui vise à reconnaître ou non le génie d’une œuvre, A. Camus n’exclut-il pas, d’une autre manière un bon nombre de grands artistes qui, malgré leur soumission ou leur fuite totale du réel, exprimèrent leur génie ?
*Poète, essayiste, dramaturge et peintre
Bibliographie:
[1] Jean Racine (1639-1699), dramaturge et poète français.
[2] Pièce en cinq actes en vers inspirée de la mythologie grecque par Jean Racine. Cette pièce qui met en scène l’amour incestueux a été créée en 1677 à Paris sous le titre : « Phèdre et Hyppolyte ».
[3] Vincent Van Gogh (1853-1890), peintre et dessinateur néerlandais.
[4] Eugène Delacroix (1798-1863), peintre français.
[5] « Paysage », Charles Baudelaire.
[6] Gustave Courbet (1819-1877), peintre, dessinateur et sculpteur autodidacte français.
[7] Paul Gauguin (1846-1903), peintre, graveur et sculpteur français.
[8] Charles Baudelaire : Curiosité esthétique. Textes intégraux publiés sous la direction de Henri Guillemin.. Presses d’Albert Kundig. Genève.
[9] Charles Baudelaire.