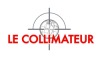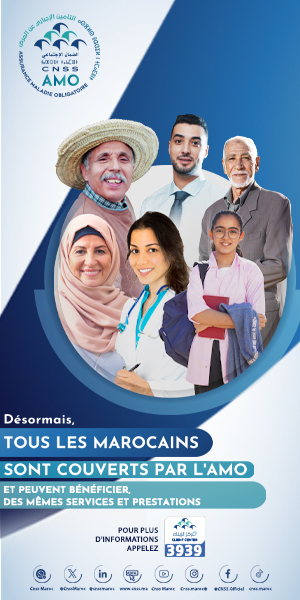A comme Absurde
(2ème partie)
« L’Art dans un certain sens, est une révolte contre le monde dans ce qu’il a de fuyant et d’inachevé…et il ne s’agit pas de savoir si l’art doit fuir le réel ou s’y soumettre, mais seulement de quelle dose exacte de réel l’œuvre doit lester pour ne pas disparaître dans les nuées, ou se trame au contraire, avec des semelles de plomb[1] ».
Cette phrase énoncée par A. Camus dans son discours de Suède remet en cause les conflits qui, depuis des siècles, s’animaient au sein des courants artistiques.
Qu’il s’agisse de la bataille entre classicisme, figuratif et abstrait, la base de mésentente est au fond toujours la même, à savoir, les artistes doivent-ils oui ou non reproduire fidèlement le réel ?
- Manet[2] a cherché toute sa vie le sens nouveau de l’informalité, du hasard et des accidents dans l’art ainsi que la palette et la lumière qui caractérisent la technique impressionniste. Il était en opposition avec la peinture historique traditionnelle (la forme de la nature) mais il était attiré par les peintres de son temps, Rembrandt, Titien…dont il copia la forme sans hésitation avant de devenir le maître de la contestation pour les jeunes peintres qui cherchaient plus ou moins l’informe dans l’art.
La question de ce passage de la forme à l’informe cache d’autres interrogations, notamment elle évoque de manière indirecte les métamorphoses que connaît la nature aujourd’hui, ou ce qu’il en reste.
Il est vrai aussi que l’art abstrait a à ses débuts tenté de tourner le dos à la représentation du monde, à sa figuration sans jamais offrir la possibilité de s’expliquer auprès du public, lui offrir les clefs de son énigme…
Dans la mesure où l’art est une révolte contre le côté absurde du monde, une revendication artistique « extrémiste » tantôt trop réaliste, tantôt trop imaginative, n’est-elle pas dans le fond vaine et inutile ?
La magie et la force de l’art ne dépassent-ils pas tous les combats, le génie d’une grande œuvre, ne figurent-ils pas avant tout dans l’harmonie du monde intérieur et du monde extérieur de l’artiste ?
Pour A. Camus, le monde est fuyant et inachevé, la condition de l’homme est réduite à celle de Sisyphe condamné à rouler sur la pente d’une montagne un rocher qui aura tôt fait de tomber et de remonter au sommet éternellement.
« L’homme est esclave de ses gestes, de ses habitudes, esclave de l’absurde[3] ».
Dans le mythe de Sisyphe, l’auteur développe ses réflexions sur un monde qui se révèle à lui comme étant une absurdité.
« Les hommes tentent d’expliquer les forces qui régissent le monde, sa naissance, son fonctionnement biologique, mais ils s’éloignent toujours de la question du but profond de son existence.[4] »
C’est dans cette optique qu’il nous dit que la découverte de Galilée, malgré la révolution scientifique qu’elle entraîna n’apporte rien qui puisse abolir ce sens de l’absurde: « qui de la terre ou du soleil tourne autour de l’autre, cela est profondément indifférent. Pour tout dire, c’est une question futile[5] ».
En effet, cela apparaît simplement comme une volonté de rendre le monde plus familier : en expliquant son fonctionnement à n’importe quelle question sur la raison de l’existence de tel ou tel individu, on peut toujours trouver une réponse. Par exemple, on expliquera le rôle du soleil par rapport à notre planète ou celui du plancton dans la chaîne alimentaire, mais ce ne sont que des valeurs apportées par l’homme et quand on y réfléchit bien, quand on observe le monde d’en haut, le caractère de l’absurde demeure comme obsession, une incohérence: « Le monde nous échappe puisqu’il redevient lui-même[6] ».
Il redevient lui-même si nous réalisons qu’un arbre est beau uniquement parce qu’il apparaît ainsi à nos yeux, parce que nous le percevons comme tel.
Un arbre n’est pas beau ni même laid. Un arbre est un arbre. L’absurde est sans cesse présent.
Ainsi, le monde est fuyant, son sens nous échappe, nous trompe, un monde qu’on explique de l’intérieur, mais qui, dans une vision d’ensemble, n’en demeure pas moins incompréhensible. Il est inachevé car « nous vivons sur l’avenir[7] ».
Nous reportons sans cesse au lendemain l’explication de l’absurde, la révélation du sens de l’existence de toutes les existences, « avec l’âge tu comprendras » est une sorte de réponse universelle, une réponse qui n’en est pas une. C’est contre cela que l’artiste se révolte, il refuse le caractère absurde du monde, il y jette ses sentiments, il y pose des valeurs lyriques.
Il se révolte contre ce monde à la fois humain et inhumain, contre ce monde avec lequel nous formons un tout mais dont nous sommes également complètement étrangers, dans lequel nous nous perdons et nous nous retrouvons en même temps.
L’art est tout d’abord une lutte contre le « fuyant », l’homme sensible fixe une émotion en perpétuel mouvement, le temps, les visages ou même une scène qui l’a profondément marqué, qu’il soit naturaliste ou romantique, dans le fond, ça n’a pas tellement d’importance.
Il est vrai que son style diffère selon l’époque ou le courant auquel il appartient mais ce désir d’immobiliser et de rendre présent, même dans le futur quelque chose qu’il a vécu, qui appartient au passé est la caractéristique de tout artiste.
Autrefois, il reproduisait surtout des événements religieux ou des scènes de guerre. Dans toutes les anciennes civilisations, nous retrouvons ce désir de fixer quelque chose de plus comme un caractère personnel, quelque chose qui l’allègerait.
On sait aujourd’hui que l’art théâtral remonte à la plus haute antiquité et on sait maintenant que la plupart des rites religieux tout aussi bien chez les Ptolémées que chez les Chaldéens contenaient en germe les rudiments d’un art du spectacle et que c’est au sixième siècle avant notre ère en Grèce, que les prémices de la tragédie[8] vont apparaître et rayonner d’un incomparable éclat, alors que la Comédie, quant à elle, ne verra le jour que tardivement vers 485 avant notre ère et ne va connaître, à ses débuts, ni action ni intrigue…
Bibliographie
[1] Albert Camus : Discours de Suède.
[2] Edouard Manet (1832-1883), peintre et graveur français.
[3] Albert Camus.
[4] Idem.
[5] Idem.
[6] Idem.
[7] Albert Camus
[8] Eschyle (525-428) qui forme avec Sophocle (499-406) et Euripide (480-406) une trilogie de génies dramatiques, est le maître incontesté considéré comme le créateur de la Tragédie avec sa pièce « Les suppliantes », devenu un monument de l’art dramatique où l’auteur a donné au verbe une place prépondérante sans négliger les ressources du spectacle… Il a atteint également le sublime et la perfection avec ses pièces : Agamemnon, Les Choéphores, Les Euménides…